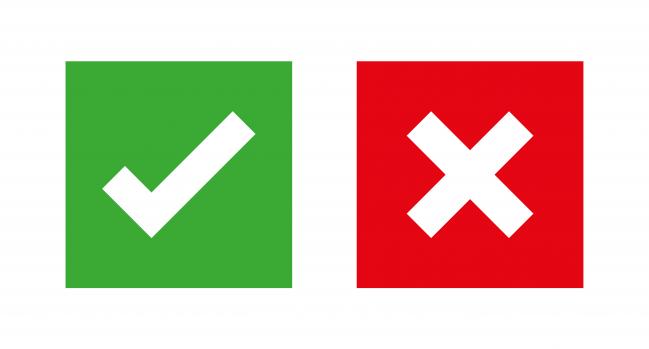Stéphanie Gressier est arrivée à la direction de l’École des Beaux-arts de Lyon alors que l’établissement était en pleine crise. L’agent chargé de l'inspection dans la fonction publique venait de faire un signalement, pour des risques psychosociaux. Lors du salon Préventica de Lyon, elle a fait part de son expérience en insistant sur les écueils à éviter.
"Je suis arrivée en février 2017 pour apaiser une situation tendue". Stéphanie Gressier a été nommée directrice adjointe en charge des ressources à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon alors que l’établissement venait de faire l’objet d’un signalement de l’Acfi (agent chargé de la fonction d’inspection, qui contrôle le respect des règles d’hygiène et de sécurité dans la fonction publique) pour situation de RPS (risques psychosociaux). Elle est revenue sur cette expérience particulière lors du salon Préventica qui se tient à Lyon les 29, 30 et 31 mai 2018. Un témoignage intéressant parce que la concernée ose insister sur les ratés.
Dans son rapport, l’Acfi évoquait "des facteurs collectifs de RPS". Deux personnes reprenaient leur travail après un burn-out, et une situation de harcèlement était dénoncée. "Il fallait réagir en urgence, faire de la prévention tertiaire", se rappelle Stéphanie Gressier. La direction décide de traiter le problème en interne, sans recourir à une expertise extérieure. Elle lance "rapidement" un groupe de travail chargé d’élaborer un plan d’action de prévention des RPS. Il est constitué, entre autres, de Stéphanie Gressier, du médecin de prévention, de l’Acfi, du responsable des ressources humaines, des élus du CHSCT, de l’acteur interne de prévention, et de salariés (professeurs, techniciens…).
"Notre calendrier était très ambitieux. On a commencé sur des chapeaux de roues". Mais tout ne se passe pas comme prévu. "Le groupe de travail est, dès la première réunion, devenu un groupe de parole". Plusieurs situations de RPS sont évoquées, les témoignages sont durs. "Quand la situation est trop à chaud, il est difficile de réfléchir à l’élaboration d’un plan d’action. Vous êtes obligés de recueillir la parole", réalise aujourd’hui Stéphanie Gressier. Alors, le groupe de travail se trouve rapidement "dans une impasse", ses membres ne sont pas experts, "ne se sentent pas compétents".
HSE
Hygiène, sécurité et environnement (HSE) est un domaine d’expertise ayant pour vocation le contrôle et la prévention des risques professionnels ainsi que la prise en compte des impacts sur l’environnement de l’activité humaine. L’HSE se divise donc en deux grands domaines : l’hygiène et la sécurité au travail (autrement appelées Santé, Sécurité au travail ou SST) et l’environnement.
Un appui extérieur est finalement sollicité. Le CDG 69 (centre de gestion) est appelé à la rescousse pour apporter un appui méthodologique. "La démarche est relancée", décrit la directrice adjointe. Depuis il a été décidé de recourir à une ligne téléphonique d’écoute, assurée par la MNT (mutuelle nationale territoriale), et de faire venir une assistance sociale une fois par mois. Surtout, un cabinet d'expert réalisera très prochainement un diagnostic des RPS dans l’école.
Mais parallèlement au diagnostic et au traitement de la problématique sur le long court, "nous avions des crises à traiter", ajoute Stéphanie Gressier. Le comité de pilotage a donc listé celles repérées. Il les a mesurées en fonction des six indicateurs définis par Michel Gollac (intensité du travail, exigences émotionnelles, souffrance éthique…), une méthode préconisée en 2014 par le ministère pour appliquer l'accord-cadre sur les RPS dans la fonction publique. Réorganisation du travail, et redéfinition des fiches de poste ont permis d’améliorer la situation de certains agents qui pâtissaient d’une "sous-charge" de travail, par exemple.
Aujourd’hui, Stéphanie Gressier qualifie la démarche empruntée d’"un peu chaotique". Avec le recul, elle recommande, dans une situation similaire, de se faire accompagner par une structure extérieure, ce qui permet d’objectiver et de décentraliser la démarche. "Accueillir la souffrance" est un métier. L’écueil est de croire que "seul le bon sens permet de traiter ces situations". Autre piège : centrer sa réflexion sur l’individu et non sur l’organisation.
D’après elle, il est essentiel de rappeler ses obligations en matière de RPS à l’employeur, lui expliquer qu’il s’agit aussi d’une démarche protectrice pour lui. Il faut bien sûr résoudre les situations d’urgence "pour refroidir le climat". "Sinon, vous n’êtes pas crédible". Faut-il encore savoir prioriser les tâche. "Pour nous, tout était urgent", se rappelle-t-elle. La directrice adjointe prône sans grande surprise le dialogue avec les élus, et la communication auprès des salariés. Engager une démarche QVT (qualité de vie travail) peut aussi être un bon moyen de positiver, croit-elle observer. Bref, "si c’était à refaire, je crois que je ne m’y prendrais pas de la même façon", reconnaît-elle.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.