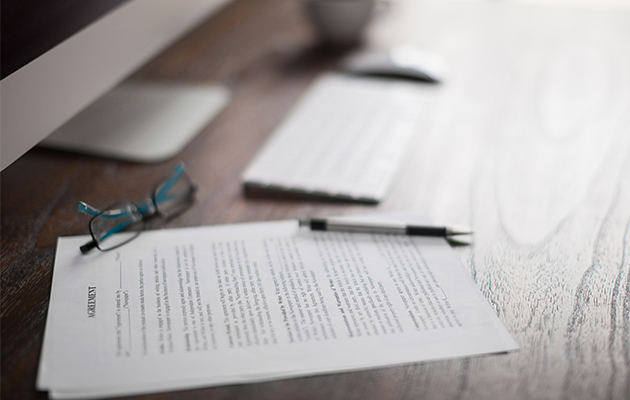Le 7 octobre dernier, le Conseil d'Etat a rendu sa décision sur le salaire minimum hiérarchique, invalidant la position restrictive du ministère du travail qui, dans ses arrêtés d'extension, avait écarté les dispositions incluant des primes dans le salaire minimum hiérarchique. Michel Morand, avocat associé au sein du cabinet HDV Avocats, analyse la portée de cette décision.
Pouvait-on s'attendre à cette position du Conseil d'Etat sur la notion de salaire minimum hiérarchique ?
Négociée par les organisations syndicales et les organisations patronales, une convention collective de travail (cct) contient des règles particulières de droit du travail (période d’essai, salaires minima, conditions de travail, modalités de rupture du contrat de travail, prévoyance, etc.). Elle peut être applicable à tout un secteur activité ou être négociée au sein d’une entreprise ou d’un établissement.
Découvrir tous les contenus liés
La décision du Conseil d'Etat n'était pas prévisible car la position prise par l'administration était claire. Le salaire minimum hiérarchique devait être limité au salaire mensuel hors accessoires ou compléments conventionnels, à l'exception toutefois de la prime pour travaux insalubres ou dangereux, laquelle peut faire l’objet d’une clause de verrouillage, en application de l’article L.2253-2 du code du travail empêchant dans cette hypothèse la primauté de l’accord d’entreprise. Or, le Conseil d'Etat juge qu'il appartient aux partenaires sociaux de définir ce qu'est un salaire minimum hiérarchique. Ce qui ressort de cette décision c'est que le Conseil d'Etat a une approche du minimum hiérarchique purement quantitative : c'est un montant qui doit être respecté par les entreprises puisque le Conseil d’Etat précise également que cette définition des minima conventionnels "ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes que celles qu’elle mentionne".
Quelles en sont les conséquences pour les entreprises ?
Le Conseil d'Etat indique clairement qu'il est possible d'atteindre le montant minimum défini dans la branche selon des modalités de rémunération différentes par accord d'entreprise. Un accord d'entreprise pourra ainsi modifier la structure de la rémunération en réduisant ou supprimant les compléments de salaire prévus par l'accord de branche (une prime mensuelle par exemple) dès lors que l'entreprise respecte bien le montant minimum prévu par la branche. Par exemple, si le salaire minimum hiérarchique est de 100 (salaire de base) + 10 (prime), les partenaires sociaux dans l'entreprise peuvent supprimer la prime de 10 sous réserve que le salarié bénéficie bien d'un salaire réel à hauteur de 110. Par cette décision, le Conseil d’Etat, d’une certaine manière, préserve l’esprit du texte de l’ordonnance du 22 septembre 2017, en laissant néanmoins à l’accord d’entreprise la possibilité d’écarter telle ou telle prime conventionnelle, la différence étant que le salaire réel du salarié doit au moins comporter le montant de cette prime.
Le Conseil d'Etat applique-t-il le principe selon lequel un accord d'entreprise peut déroger à un accord de branche lorsque cela est prévu dès lors qu'il prévoit des "garanties au moins équivalentes" ?
Le Conseil d'Etat ne s'est pas placé sur le terrain des garanties au moins équivalentes. Les garanties au moins équivalentes ne s'appliquaient pas jusque là au complément de salaire car l'administration avait écarté du minimum conventionnel les accessoires à la rémunération de base. Le Conseil d'Etat s'est inspiré de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la méthode de comparaison entre la définition du salaire conventionnel et le salaire réel versé au salarié. La Cour de cassation avait déjà admis dans cette méthode de comparaison qu’il appartenait aux partenaires sociaux de définir les éléments de rémunération qui pourraient participer ou non à cette comparaison.
De quelle marge de manoeuvre disposent les branches à compter de cette décision ?
Deux options s'offrent aux partenaires sociaux. Ils peuvent décider que le salaire minimum hiérarchique n’est composé que du salaire de base hors compléments de rémunération, ou bien que le salaire minimum hiérarchique inclue le salaire de base et tout ou partie des compléments de rémunération prévus par la convention collective nationale.
Cette décision du Conseil d'Etat va ouvrir de grands chantiers dans les branches autour de nouvelles réflexions et discussions sur le salaire minimum hiérarchique puisque le Conseil d'Etat redonne la main aux partenaires sociaux.
Reste à savoir si les partenaires sociaux peuvent intégrer toutes les primes dans le salaire minimum hiérarchique ou s'ils ne peuvent y inclure que les seules primes qui correspondent à des éléments de rémunération accessoires qui sont des contreparties au travail effectif. L'intégration de la prime d'ancienneté ou d'assiduité par exemple soulève une vraie interrogation. Autrement dit, la notion de minima hiérarchique emporte-t-elle malgré tout l’idée que les primes qui peuvent faire partie de cette définition sont celles, et seulement celles, qui constituent la contrepartie du travail effectif ? Le ministère du travail pourrait ainsi refuser l'extension d'un salaire minimum hiérarchique incluant des primes ne répondant pas à cette finalité. C’est la suite de l’histoire qui le dira.