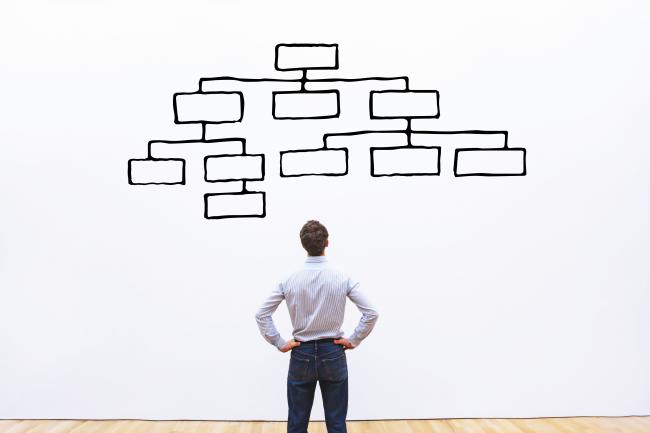Bon nombre des mesures de la loi du 2 août attendent d’être précisées par le comité national de prévention et santé au travail. Avant de mettre sur pied cette nouvelle instance tripartite, faut-il encore décider de sa composition, son mode de délibération et son fonctionnement. Des sujets de débat entre partenaires sociaux et administration.
“Les partenaires sociaux sont très mobilisés sur la façon dont le CNPST et les CRPST vont fonctionner”, déclarait il y a quelques semaines Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État à la santé au travail. C’est peu dire. Et on peut les comprendre. Ce comité national de prévention et santé au travail et ses déclinaisons régionales, dont les créations ont été programmées par l’accord national interprofessionnel de décembre 2020 et enregistrées par la loi du 2 août 2021, auront des missions stratégiques.
Dans leur accord, les partenaires sociaux résument : ce CNPST “résulte d’un élargissement des missions du GPO (groupe permanent d’orientation) du Coct (conseil d’orientation des conditions de travail)”. La loi valide qu’il sera chargé de définir l’offre socle des SSTI (renommé SPSTI pour services de prévention et de santé au travail interentreprises), les référentiels des cahiers de charge des certifications de ces mêmes services, et les modalités de mise en œuvre du passeport prévention, ou encore, de participer à l’élaboration du plan santé travail et “des politiques publiques en matière de santé au travail” et “à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines”.
| ► Lire aussi : |
|---|
Un avant projet de décret portant sur la création de ces comités a été transmis aux organisations syndicales et patronales il y a quelques semaines. Le texte prévoit de supprimer la moitié des commissions spécialisées du Coct. Celles sur les risques physiques chimiques et biologiques, sur les équipements de travail et EPI et sur les pathologies professionnelles fusionneraient. La commission relative aux questions transversales, aux études et à la recherche et celle sur les acteurs de la prévention en entreprise ne formeraient qu’une. Tous les représentants interrogés nous ont fait part de leur désaccord. “Les risques professionnels et les tableaux de maladie professionnelle sont des sujets délicats et qui demandent des compétences très particulières. En fusionnant, on risque de diluer la pertinence des travaux”, commente par exemple Anne-Michèle Chartier, de la CFE-CGC.
| ► Lire aussi :
Loi santé au travail : le compte à rebours des textes d’application est lancé |
|---|
Consensus ou vote majoritaire ?
Aussi, les débats portent sur la composition et le mode de délibération de ce nouvel organe. Aujourd’hui, le GPO rend des avis par consensus. Par souci de rationnalisation et d’efficacité, et parce que des aspects très importants de la réforme doivent être précisées par le comité (l’offre socle principalement) et ce très vite, l’administration voudrait que les décisions soient prises par vote majoritaire.
Sur ce point, les avis divergent. “Je trouve l’obligation de consensus propre au GPO relativement intéressante, elle nous oblige à sortir des postures”, estime Jérôme Vivenza, de la CGT, seule organisation à ne pas avoir voté l’ANI. “On pense que sur les sujets de santé au travail le consensus n’est pas très difficile à obtenir. Il ne s’agit pas d’un sujet très conflictuel. Les représentants d’employeurs et de salariés arrivent en général à s’entendre dessus”, croit observer Pierre-Yves Montéléon, de la CFTC, qui prône lui aussi le consensus. De son côté, la CFE-CGC, par la voix d’Anne-Michèle Chartier, explique comprendre “la nécessité d’une méthodologie” pour s’accorder et trancher à un moment sur les sujets très factuels listés par l’ANI et la loi. La loi prévoit que la DGT reprenne la main à défaut d'entente. Il y a fort à parier que cela motive les partenaires sociaux à trouver un consensus.
Mais qui dit vote majoritaire dit enjeu de représentativité. Faut-il accorder une voix à chaque organisation ou bien pondérer en fonction de la mesure d'audiences de chaque organisation syndicale et patronale ? Et là, les différentes organisations, parce qu’elles n’ont pas toutes le même poids notamment, ne tiennent pas le même discours. D’après nos informations, côté patronal, le risque de prééminence du Medef, qui posséderait trois voix (contre une pour l’U2P et une pour la CPME) ne passe pas. Parallèlement, est également arrivée l’idée (lors du dernier renouvellement du GPO et au Sénat lors des débats sur la loi) de faire entrer dans cette instance, côté patronal, les organisations multiprofessionnelles (FNSEA, Udes et Fesac). Une idée qui n’est pas reprise dans l’avant projet de texte mais à laquelle tient beaucoup la CPME, nous explique Éric Chevée, son vice-président des affaires sociales.
Aussi, plusieurs organisations auraient aimé que l’augmentation des prérogatives dévolues aux partenaires sociaux s’accompagne de moyens humains (via des autorisations d’absence par exemple) et financiers (pour commander des études et faire appel à des experts notamment). La première mouture ne prévoit rien à ce sujet.
Ces arbitrages sont si stratégiques que la question est remontée jusqu’à Matignon, d’après nos informations. Le projet de décret devrait être présenté aux membres du GPO mi novembre.
| ► Lire aussi : |
|---|
HSE
Hygiène, sécurité et environnement (HSE) est un domaine d’expertise ayant pour vocation le contrôle et la prévention des risques professionnels ainsi que la prise en compte des impacts sur l’environnement de l’activité humaine. L’HSE se divise donc en deux grands domaines : l’hygiène et la sécurité au travail (autrement appelées Santé, Sécurité au travail ou SST) et l’environnement.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.