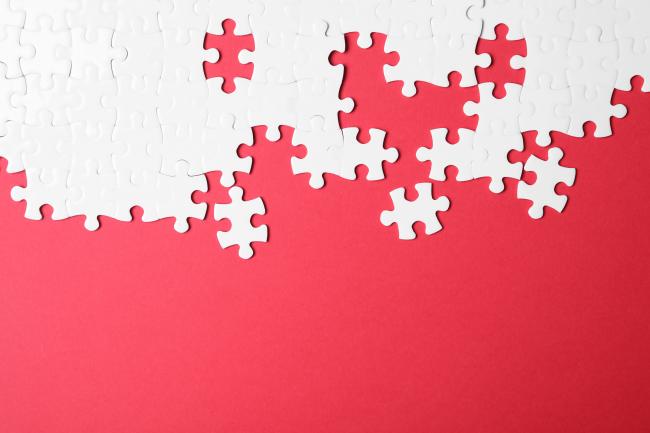En plus du suivi médical, définir l'offre minimale que les services de santé au travail devront fournir aux entreprises va occuper les acteurs de la santé au travail après l'adoption de la PPL. La cotisation va-t-elle augmenter ? "Ce serait complètement inaudible", prévient Charlotte Lecocq devant les journalistes de l'Ajis.
"L'enjeu est de garantir que les services de santé au travail ne se limitent pas au suivi médical individuel, mais qu'il y ait vraiment toute la prévention collective qui soit amenée", rappelle Charlotte Parmentier-Lecocq le 30 juin 2021, lors d'une table ronde organisée par l'Ajis (association des journalistes de l'information sociale) sur la proposition de loi santé au travail, un texte que porte la députée LREM du Nord, et qui est en ce moment entre les mains du Sénat. En obtenir davantage et plus clairement des services de santé au travail en échange de la cotisation réglée par les employeurs : c'est un des points majeurs du texte (article 8) , qui découle de l'ANI (accord national interprofessionnel) de décembre 2020.
Dans l'ANI, les partenaires sociaux ont décidé d'exiger des SST (services de santé au travail) une "offre socle minimale satisfaisant aux trois missions suivantes : prévention, suivi individuel des salariés, prévention de la désinsertion professionnelle". Alors que la loi est prévue pour entrer en vigueur au 31 mars 2022, beaucoup restera à faire : les partenaires sociaux devront préciser le cahier des charges qui présidera à la mise en place d'une certification, avec les indicateurs de suivi nécessaires.
"On avait besoin de cette offre socle, de la définir, puis de la suivre, au bénéfice surtout des petites entreprises", expose Anne-Michèle Chartier, déléguée nationale santé au travail à la CFE-CGC et à ce titre négociatrice de l'ANI. Certains services ont ces dernières années développé des expérimentations qui "ne convenaient pas aux partenaires sociaux", raconte-elle. Telles que des réunions de prévention collectives en lieu et place de la visite d'embauche – une idée défendue par Prism'emploi pour les intérimaires.
"On avait besoin de cette redéfinition de l'action des SST pour la cohérence", reconnaît Martial Brun, directeur général de Présanse, association qui rassemble la quasi-totalité des services de santé au travail interentreprises, et représente essentiellement les directions de ces services. Le suivi médical "avait fini par être perçu comme une réponse de conformité réglementaire, explique-t-il. Pourquoi faites-vous des visites ? Parce que c'est obligatoire. À quoi ça sert ? Telle n'est pas la question. On en était là".
"Il y avait aussi un besoin d'harmoniser, ajoute Charlotte Parmentier-Lecocq. On voyait des différences importantes d'un territoire à l'autre, d'une entreprise à l'autre. […] Maintenant, il faut qu'il y ait moins de disparités."
HSE
Hygiène, sécurité et environnement (HSE) est un domaine d’expertise ayant pour vocation le contrôle et la prévention des risques professionnels ainsi que la prise en compte des impacts sur l’environnement de l’activité humaine. L’HSE se divise donc en deux grands domaines : l’hygiène et la sécurité au travail (autrement appelées Santé, Sécurité au travail ou SST) et l’environnement.
Quels sont les services que pourront attendre les entreprises ? En plus du suivi individuel des salariés et de la mise en place d'une "cellule" spécifique pour la PDP (prévention de la désinsertion professionnelle), l'ANI a commencé à lister les exigences. D'abord, que la fiche d'entreprise – dans laquelle le médecin du travail repère les risques professionnels en situation de travail et donne les premiers conseils de prévention – soit bel et bien faite, et mise à jour. Ce document n'est aujourd'hui remis qu'à 40 % des entreprises, selon les chiffres de Martial Brun.
Le SST devra aussi aider à réaliser le DUERP (document unique de prévention des risques professionnels), mener des actions de prévention collectives et individuelles, ou encore apporter des conseils lors de la conception des locaux de travail. Il devra faire des études de postes, que cela soit pour les TMS, les RPS, ou les risques chimiques.
Lors des discussions entre les partenaires sociaux, "le sujet des risques chimiques est apparu comme posant vraiment des problèmes aux TPE-PME", raconte Anne-Michèle Chartier. Le patronat représentant ces entreprises a plaidé pour qu'elles soient exonérées du document unique. Il n'en a pas été question. "C'est pour cela qu'on a voulu une aide effective des SST, pour accompagner des petites entreprises sur des risques compliqués pour elles, comme le risque chimique, ou les RPS." Quand certains services ont des ingénieurs ou des toxicologues dans leur équipe, d'autres n'ont que le binôme médecin-infirmier. Pourtant, bien souvent, l'employeur paie à peu près le même niveau de cotisation, autour des 100 euros / an / salarié.
La cotisation va-t-elle grimper ? "Très clairement, on ne souhaite pas qu'il y ait une inflation des cotisations aux SST. Ce serait complètement inaudible, inacceptable par les chefs d'entreprise, qui ont déjà vu leur cotisation parfois augmenter de façon très forte, alors que le nombre de visites médicales a diminué – en tout cas leur fréquence. Il n'y aura pas d'adhésion là-dessus", prévient Charlotte Parmentier-Lecocq.
L'ANI demande "un contrôle financier strict, en toute transparence" et décide que "l’amplitude des cotisations ne pourra pas excéder 20 % du coût moyen national de l’offre socle". La précision n'a pas été reprise dans le texte initial mais a été ajoutée par les sénateurs en commission des affaires sociales, en renvoyant à un décret le soin de fixer le taux du plafond.
"J'attends le moment où on va définir le coût moyen national de l'offre socle, déclare Martial Brun. D'abord, il faut savoir ce pour quoi on va payer, ensuite décider de qui définit le prix moyen, et comment il le définit. Et après, on pourra éventuellement prévoir un encadrement de la cotisation. Quelle est l'exigence des pilotes que sont l'État et les partenaires sociaux ? C'est ça qui va permettre de dire si cela tient ou non dans les moyens actuels ; ce sera aussi notre rôle de le mettre en évidence."
Anne-Michèle Chartier regrette que la "transparence financière des services", demandée dans l'ANI, ne soit pas pleinement retranscrite dans la proposition de loi et se limite pour l'instant à l'article 10 qui exige que le SST communique à ses adhérents et au futur CRPST (comité régional de prévention et de santé au travail) "le montant des cotisations, la grille tarifaire et leurs évolutions". Alors que le nombre de médecins baisse structurellement, du fait de la pénurie qui s'accentue, l'enveloppe globale de la masse salariale des services ne bouge pas, selon elle. "On aimerait en savoir un peu plus et que les services présentent leurs comptes."
Une fois la réforme en œuvre, "on aura le commissaire aux comptes, le trésorier salarié, la certification de tierce partie… Tout ça nous va très bien. Que l'on sorte enfin de ces suspicions, pour regarder si le service est rendu et à quel prix", répond Martial Brun. Les différences de tarif seraient le plus souvent dues, selon lui, à la composition de l'équipe pluridisciplinaire : "si elle est plus ou moins étoffée, plus ou moins médicalisée, ça peut faire des variations très importantes".
En tout cas, pour le DG de Présanse, avec "17 000 collaborateurs implantés sur tout le territoire, les moyens existent", et "la difficulté sera de prioriser [les missions]". Reste à voir si les priorités couleront de source une fois que le cahier des charges pour l'offre socle sera bien défini.
"Les médecins ne sont pas seuls, il y a aujourd'hui des ressources dans les services qui sont en capacité de répondre", défend Charlotte Parmentier-Lecocq. La députée mise aussi sur les branches professionnelles, qui peuvent pré-mâcher une partie du travail : "elles doivent s'engager sur l'évaluation des risques liés à leur secteur d'activité, et la définition d'actions qui pourront ensuite être proposées et relayées par les SST".
La syndicaliste Anne-Michèle Chartier rappelle que les référentiels pénibilité élaborés par les branches professionnelles n'ont pas été une grande réussite. "Parce qu'ils n'ont pas été discutés : ils ont été faits au niveau des branches, mais avec la partie patronale", explique-t-elle. Et d'insister, désormais, "quand on dit branche dans l'ANI et dans la loi, ça doit être paritaire".
"En fait, constate la députée, on ne manque pas vraiment de ressources, il y a beaucoup d'acteurs en santé au travail, on manque plutôt d'efficacité, de fluidité, de synergie et de lisibilité. C'est vers ça que la réforme tend." La proposition de loi sera en séance publique au Sénat les 5 et 6 juillet. Puis les parlementaires des deux chambres se réuniront mi-juillet, avec l'objectif de s'accorder directement sur un texte commun, qu'ils devront ensuite adopter dans leurs plénières respectives d'ici la fin du mois. La loi devrait être publiée cet été.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.