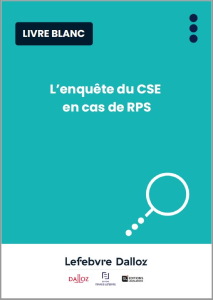AvoSial (1) publie des chroniques pour actuEL-RH. Aujourd'hui, François Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, revient sur les arrêts du 13 septembre 2023 et s’interroge sur la responsabilité de l’Etat qui n’a pas transposé une directive communautaire en droit interne. Ce qui entraîne un préjudice pour les entreprises en cas de condamnation.
 Un nouveau feuilleton. Ce qu’il y a de formidable avec le droit du travail est que l’on ne s’y ennuie jamais. Alors que, depuis quelques mois, l’on peinait à se passionner encore pour la longue et désormais épuisante saga du barème, voilà que la Chambre sociale de la Cour de cassation, vient de lancer, avec grand renfort de publicité, un tout nouveau feuilleton - déjà palpitant : l’acquisition des congés payés en période de suspension du contrat de travail. On l’attendait certes depuis plusieurs années, et l’on avait fini par désespérer de pouvoir le regarder un jour. Cela valait cependant la peine d’attendre : le premier épisode, constitué de cinq arrêts en date du 13 septembre 2023, était flamboyant, au-delà des espérances : un bouleversement du droit positif, certes prévisible, mais néanmoins spectaculaire ; une question de hiérarchie des normes qui oblige à réfléchir à nouveau à notre rapport au droit de l’Union européenne ; et des problèmes d’application pratiques incommensurables - toutes les directions de ressources humaines ne parleraient plus que de cela. Comme c’est au fond toujours le cas dans l’hypothèse d’un revirement de jurisprudence, les décisions posent en effet plus de problèmes qu’elles n’en résolvent, même si le communiqué de presse qui les accompagne est plus prolixe quant à leur portée que les arrêts eux-mêmes - c’est devenu, hélas, une (mauvaise) habitude.
Un nouveau feuilleton. Ce qu’il y a de formidable avec le droit du travail est que l’on ne s’y ennuie jamais. Alors que, depuis quelques mois, l’on peinait à se passionner encore pour la longue et désormais épuisante saga du barème, voilà que la Chambre sociale de la Cour de cassation, vient de lancer, avec grand renfort de publicité, un tout nouveau feuilleton - déjà palpitant : l’acquisition des congés payés en période de suspension du contrat de travail. On l’attendait certes depuis plusieurs années, et l’on avait fini par désespérer de pouvoir le regarder un jour. Cela valait cependant la peine d’attendre : le premier épisode, constitué de cinq arrêts en date du 13 septembre 2023, était flamboyant, au-delà des espérances : un bouleversement du droit positif, certes prévisible, mais néanmoins spectaculaire ; une question de hiérarchie des normes qui oblige à réfléchir à nouveau à notre rapport au droit de l’Union européenne ; et des problèmes d’application pratiques incommensurables - toutes les directions de ressources humaines ne parleraient plus que de cela. Comme c’est au fond toujours le cas dans l’hypothèse d’un revirement de jurisprudence, les décisions posent en effet plus de problèmes qu’elles n’en résolvent, même si le communiqué de presse qui les accompagne est plus prolixe quant à leur portée que les arrêts eux-mêmes - c’est devenu, hélas, une (mauvaise) habitude.
On imaginait donc que l’essentiel de la saga se concentrerait sur ces difficultés. C’était sans compter l’imagination redoutable des scénaristes qui, dès les deux épisodes suivants, n’ont pas ménagé les coups de théâtre : un arrêt de la CJUE, d’abord, qui était attendu, mais qui, dans ce contexte, n’est pas compliquer un peu plus la situation et, surtout, un nouvel arrêt de la Chambre sociale en date du 15 novembre 2023 renvoyant cette fois deux QPC au Conseil constitutionnel, lesquelles posent toutes les deux la question de la conformité des articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5° du code du travail à la Constitution et plus précisément au droit à la santé et au repos garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.
On imagine aisément la finalité de cette transmission à la rue de Montpensier : outre qu’indubitablement, le critère tiré du caractère "sérieux" de la question posée était caractérisé et que la transmission s’imposait de ce seul fait, la Cour de cassation y a sans doute vu aussi l’occasion de faire sécuriser sa toute jeune jurisprudence par le Conseil constitutionnel, tout en pariant que, par l’effet d’une possible - mais non certaine - abrogation, cela pourrait inciter le législateur à faire à ce qu’il n’a pas voulu faire pendant 10 ans : transposer l’article 7 de la directive 2003/88/CE, telle qu’interprété par la CJUE au regard l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, éventuellement d’ailleurs en aménageant les effets de cette éventuelle abrogation.
L’avenir dira ce qu’il en est et l’on attend bien entendu ce nouvel épisode avec l’impatience des fans. Le Conseil constitutionnel a fixé au 7 décembre prochain la date limite des interventions volontaires dont on pressent qu’elles seront nombreuses. La décision devrait être rendue dans le courant du mois de janvier. Il n’est pas impossible qu’entre-temps, le législateur, grand absent pour le moment, se saisisse du problème - les récentes déclarations du ministre du travail semblent indiquer qu’un projet de loi est également envisagé pour le mois de janvier.
Il est en effet dans cette série, un personnage dont on a encore assez peu parlé, qui ne s’est pas beaucoup montré et auxquels les scénaristes semblent – pour l’instant - faiblement s’intéresser : l’Etat. Dans cette histoire, le personnage devrait pourtant être central. Car si l’on en est là, c’est quand même un peu de sa faute, et même de sa faute entièrement, si l’on songe que dès 2013, et plus encore à compter de 2018, la Cour de cassation avait fermement appelé son attention, dans pratiquement chacun de ses rapports annuels, sur l’incompatibilité du droit français avec le droit de l’Union européenne tandis que le Conseil d’Etat – cela n’a pas été suffisamment souligné – faisait déjà application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, tel qu’interprété par la CJUE dans les rapports entre les établissements publics et leurs agents qu’ils fussent fonctionnaires ou agents contractuels, considérant que celle-ci avait un effet direct vertical.
Dire que les arrêts du 13 septembre 2023 aurait pris l’État au dépourvu n’est évidemment pas envisageable et si d’aucuns soutiennent, non d’ailleurs sans quelques arguments parfois pertinents, que l’interprétation donnée à la directive, par la CJUE, est contestable, et ne correspond pas aux engagements qui avaient été initialement pris par les Etats [1], il demeure que la France ne peut prétendre avoir ignoré ni que cette interprétation existait, ni qu’elle était contraire au droit français. D’où cette question, qui taraude beaucoup d’entreprises françaises et qui n’est pas sans légitimité : puisque c’est l’Etat, et plus précisément le législateur, qui n’a pas agi, sera-t-il possible d’engager sa responsabilité lorsque viendra le moment où certains salariés, dont le contrat de travail a connu une période de suspension, saisiront la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de congés payés, à laquelle, compte tenu des arrêts du 13 septembre 2023, il devrait, en l’état actuel de la législation, être fait droit, faute pour le législateur d’être - pour l’instant - encore intervenu pour aménager les effets de cette toute nouvelle jurisprudence.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Il est certain que l'absence comme le retard à transposer une directive communautaire en droit interne constitue un manquement à une obligation générale de l'État, de nature à engager sa responsabilité. La jurisprudence européenne l’a très tôt affirmé [2]. Longtemps, cependant, le juge administratif s’est montré réticent à mettre pleinement en œuvre ce principe. En ce qui concernait la non-transposition du droit de l’Union européenne, il a en effet longtemps distingué suivant la source de l’obligation. Si l’obligation résultait d’un règlement, le régime de la responsabilité pour faute s’appliquait [3] ; il suffisait donc de démontrer, conformément au droit commun de la responsabilité, une faute - laquelle consistait dans le fait de ne pas avoir respecté le droit de l’Union - un préjudice et, bien entendu, un lien de causalité entre les deux. Si ces trois conditions classiques étaient caractérisées, la responsabilité pouvait être mise en œuvre.
En revanche, si l’obligation résultait d’une directive, le fondement de l'action en réparation était alors la responsabilité sans faute de l’État, mode de réparation propre au droit administratif dont l’intitulé pourrait faire croire qu’elle serait plus facile à engager que la responsabilité de droit commun, dite pour faute, puisque précisément elle exonère le requérant d’avoir à la prouver, mais qui, en réalité, est tout sauf aisée à mettre en œuvre dès lors que si ce second mode de responsabilité n’implique pas de démontrer une faute, il suppose de démontrer un préjudice dit "anormal et spécial". En effet, le fondement d’une telle responsabilité est la rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. L’idée générale qui fonde ce régime est que la responsabilité de l’État, lorsque celui-ci agit dans l’intérêt général, ne peut être engagée que si son action cause à un individu ou une catégorie d’individus un préjudice spécifique, allant au-delà de ce que doit normalement supporter un citoyen. En d’autres termes, il faut que l’action de l’État entraîne, pour le requérant, une charge telle que le principe d’égalité des citoyens devant la loi s’en trouve rompu.
La responsabilité de l’État en cas de non-transposition d’une directive a donc longtemps été fondée sur ce modèle - ce qui en dit long sur la portée que le Conseil d’État attribuait aux directives surtout lorsqu’on sait que ce système de responsabilité n’est censé concerner que des hypothèses où l’action de l’État est régulière. Concrètement, l’appliquer à la non-transposition des directives signifiait que l’absence de transposition ne constituait pas, du point de vue du droit français, une faute. La jurisprudence du Conseil d’État était à cet égard cohérente avec les principes issus de la jurisprudence Conh-Bendit dont on se souvient qu’elle prévoyait qu’un justiciable ne pouvait pas invoquer, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel, le bénéfice des dispositions d’une directive non transposée, fussent-elles claires et inconditionnelles et même si que le délai de transposition était expiré [4]. En bref, c’était l’époque où le Conseil d’Etat déniait tout effet direct aux directives [5].
Ce temps est révolu dès lors que, même avant l’arrêt Perreux [6], dont on sait qu’il a normalisé les rapports du Conseil d’État avec le droit de l’Union européenne, le Conseil d’État a fait évoluer sa jurisprudence en consacrant ce qu’il est désormais classique d’appeler un "régime de responsabilité du fait des lois", que certains auteurs continuent à classer dans les régimes de responsabilité sans faute alors qu’en réalité, il vient plutôt consacrer un régime de responsabilité dans lequel la faute est à présent présumée.
Par un arrêt d’assemblée, dit Gardedieu du 8 février 2007, le Conseil d’État a en effet jugé que l’État est tenu de réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. Si la décision a été rendue à propos de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la généralité de la formule ne laisse guère de doute quant à la portée de la solution : ce sont tous les engagements internationaux de la France qui se trouvent concernés, ce qui inclut évidemment le droit de l’Union européenne. Il en résulte que même en présence d’une directive, la responsabilité de l’État peut être engagée et ce, sans qu’il soit encore nécessaire de solliciter la preuve d’un préjudice anormal et spécial.
Certes, l’arrêt Gardedieu n’envisageait que l’hypothèse de l’intervention d’une loi contraire à un engagement international, ce qui vise spécifiquement l’hypothèse d’une loi adoptée postérieurement à un engagement préexistant de la France et d’un acte positif de l’État réalisé en méconnaissance d’un tel engagement. Or, en cas de non-transposition d’une directive, aucune action de l’État n’a par principe eu lieu, tandis qu’il arrive – c’est le cas en l’occurrence – que l’absence de transposition se matérialise par le maintien dans l’ordre juridique interne de dispositions contraires à une directive adoptée postérieurement aux dispositions nationales.
L’arrêt Gardedieu permet-il, dans un tel cas, d’engager la responsabilité de l’État ? Si, à titre personnel, on n’en a jamais tellement douté, la question semble aujourd’hui réglée depuis que par un arrêt Société hôtelière Tour Eiffel [7] le Conseil d’État a précisé que la responsabilité de l’État peut être engagée "en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'application d'une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France".
La décision était relative à la question de la responsabilité de l’État du fait des lois inconstitutionnelles, mais la formule utilisée, qui, d’une part, se fonde sur les exigences générales de la hiérarchie des normes et qui, d’autre part, se réfère désormais non plus à l’adoption, mais à "l’application" d’une loi contraire notamment aux engagements internationaux, invite à considérer que l’abstention de l’État qui maintient dans l’ordre juridique des dispositions contraires à une directive européenne adoptée postérieurement, relève du champ d’application de ce régime de responsabilité. Elle doit donc pouvoir l’être, s’agissant de l’acquisition des droits à congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail. D’ailleurs, si le Conseil d’État n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer, certaines juridictions du fond, elles, l’ont déjà fait, à l’instar de la cour administrative d’appel de Versailles qui, 17 juillet dernier, a condamné l’État à indemniser trois organisations syndicales interprofessionnelles du préjudice subi collectivement par la profession du fait de l’absence de transposition de l’article 7 de la directive 2003/88/CE [8].
Pour ce faire, la cour administrative d’appel a rappelé que l’article 7§1 de la directive n°2003/88/CE fait obstacle à ce que les États limitent unilatéralement le droit au congé annuel payé conféré à chaque travailleur, en appliquant une condition d’ouverture de ce droit qui aurait pour effet d’exclure certains travailleurs du bénéfice de ce dernier alors que l’article L.3141-5 du code du travail opère une distinction entre les périodes de suspension du contrat de travail selon leur origine.
Elle en a déduit que les restrictions introduites par cet article sont incompatibles avec l’article 7§1 de la directive européenne et en a conclu que l’État français n’avait pas correctement transposé la directive et que ce retard de transposition engageait la responsabilité de l’État en réparation du préjudice moral subi de ce fait par les salariés que représentent les organisations syndicales requérantes. Elle a ainsi condamné l’État à indemniser chaque organisation syndicale à hauteur de 10 000 euros en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente. La responsabilité de l’État n’est donc pas que théorique.
Il reste à savoir si les entreprises pourraient s’en prévaloir, de sorte à être garanties par l’État d’éventuelles condamnations prononcées à leur encontre par des juridictions prud’homales devant lesquelles serait invoquée la toute nouvelle jurisprudence issue des arrêts du 13 septembre 2023. Certains en doutent, à commencer par l’administration qui semble même - mais comment pourrait-elle dire autre chose ? - exclure cette possibilité. Outre que la responsabilité de l’État ne pourrait être mise en œuvre que dans un second temps, une fois la condamnation par le juge judiciaire prononcée - le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire s’oppose en effet à ce que l’État puisse être appelé en garantie directement devant la juridiction prud’homale, ce qui constituerait pourtant la voie la plus efficace – deux arguments sont généralement avancés : les entreprises ne subiraient aucun préjudice dès lors que la directive ne confère de droits qu’aux salariés qui, seuls, auraient donc été lésés ; elles seraient en outre elles-mêmes fautives dès lors que la CJUE ayant jugé, dès 2018, que la directive était d’effet direct horizontal, il leur appartenait de passer outre le code du travail.
On ne s’appesantira pas longtemps sur ce second argument, aperçu en creux dans quelques pages doctrinales [9]. Il n’est ni moralement, ni juridiquement raisonnable de reporter sur les entreprises la faute d’un défaut de transposition qui incombe à l’Etat. Les dispositions de l’article 7 de la directive, telles qu’interprétées par la CJUE à lumière de la Charte, avaient certes été déclarées d’application directe horizontale par la CJUE dès 2018. Mais il a fallu attendre le 13 septembre 2023 pour que cela se traduise dans la jurisprudence française qui, jusqu’à ces arrêts, s’en est tenue à appliquer le code du travail tout en alertant les pouvoirs publics sur la nécessité d’une transposition de la directive.
Dans ce cadre-là, comment opposer aux entreprises françaises une directive qui était certes directement applicable mais que même la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire n’appliquait alors pas ? Fallait-il donc être plus royaliste que le roi quand le code du travail faisait écran ? Ce n’est guère entendable. Surtout quand on sait que la plupart des entreprises ignoraient tout et des arrêts de la CJUE et des rapports de la Cour de cassation pointant depuis 2013 la méconnaissance par le droit français des obligations résultant de la directive. Mis à part - et ce n’est même pas sûr - les services juridiques de certaines grandes entreprises mondialisées, qui, dans le tissu des PME et TPE qui fournit le gros des bataillons de salariés en France, se doutait qu’il existait un risque à appliquer doctement le code du travail ? L’hypothèse était inconcevable, alors que le réflexe consistant à respecter le code du travail était légitime. Car c’est cela qu’ont fait les entreprises françaises durant toutes ces années : appliquer la loi, telle qu’elle figurait au code du travail. Faire reposer aujourd’hui sur elles une faute qui résulte au premier chef d’un défaut de transposition par l’État de dispositions issues du droit de l’Union européenne, a tout l’air d’une défausse.
Plus complexe est peut-être la question du préjudice subi par les entreprises en cas de condamnation à des répétitions de congés payés pour les périodes relevant du passé. La directive, c’est un fait, confère des droits aux salariés, dont la Cour de cassation reconnait désormais qu’ils prévalent sur les dispositions du code du travail. Mais avant les arrêts du 13 septembre 2023, ces droits n’en existaient pas moins puisqu’ils résultaient de la directive telle qu’interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux. Or, peut-on voir un préjudice dans le fait de devoir régler aux salariés des sommes correspondant à des droits que ceux-ci tenaient d’une directive et ce, même si la directive n’a pas été transposée ?
La question, à n’en point douter, sera vivement débattue et le sera d’autant plus que, classiquement, dans la jurisprudence européenne, la responsabilité de l’État du fait de l’absence de transposition d’une directive, suppose l’attribution de droits précis et inconditionnels. De là à en déduire que l’action en responsabilité n’est ouverte qu’à ceux auxquels ces droits sont attribués, il n’y a qu’un pas que l’administration n’hésitera probablement pas à franchir. Il reste que le principe applicable depuis l’arrêt Société hôtelière Tour Eiffel Suffren est celui de la réparation de tous les préjudices qui résultent de l'application d'une loi méconnaissant les engagements internationaux de la France.
Or, si bien entendu, les droits ont été conférés par la directive aux salariés, de sorte que ce sont eux qui, au premier chef ont subi un préjudice, il demeure que, du fait de l’absence de transposition de la directive par l’État, leurs employeurs se retrouvent exposés à des actions en justice auxquels ils ne s’attendaient pas alors surtout que, comme on l’a dit, pour la plupart d’entre eux, ils avaient le sentiment d’appliquer la loi. Les sommes n’ont pas été provisionnées, quand il apparait que si certaines créances se montreront certainement modestes, d’autres pourraient ne pas l’être surtout si la Chambre sociale de la Cour de cassation en venait - ce qui ne parait pas complètement improbable - à confirmer la thèse qui a été défendue par son Doyen dans certaines de ses interventions publiques [9] suivant laquelle la prescription n’ayant jamais commencé à courir, les salariés pourraient demander un rappel de congés payés depuis le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux, à la lumière de laquelle, on l’a vu, a été interprétée la directive 2003/88/CE. Et puis que dire des sommes qui, si cette solution était retenue, seraient réclamées pour des périodes comprises entre le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur de la Charte, et le 4 octobre 2018, date de l’arrêt de la CJUE ayant affirmé l’effet direct horizontal du droit à congés payés en période de suspension du contrat de travail.
Comment en effet soutenir, avant cet arrêt, que les entreprises auraient dû appliquer un droit dont il n’avait pas été auparavant jugé que les salariés pouvaient s’en prévaloir à leur endroit ? Déjà certainement engagée, au moins partiellement, du seul fait que l’Etat, en n’intervenant pas, a créé un contexte dans lequel les entreprises ont pu croire légitimement qu’elles n’étaient pas tenues de faire acquérir des congés à des salariés dont le contrat de travail était suspendu, sa responsabilité ne fait plus aucun doute pour toutes les périodes qui précédent l’affirmation de l’effet direct horizontal dès lors qu’à cette époque, il restait seul destinataire des obligations nées de la directive.
Une précision doit cependant être formulée : dans la logique du droit administratif, la responsabilité de l’Etat ne pourra être mise en œuvre qu’en présence d’un préjudice certain, lequel ne sera caractérisé que si et seulement si existe une décision passée en force de jugée. La responsabilité de l’Etat suppose donc au préalable l’étape du contentieux.
[1] AvoSial est une association d'avocats en droit du travail et de la sécurité sociale qui conseillent et représentent les employeurs en justice.
[2] CJCE 19 novembre1991, Francovich et Bonifaci ; CJCE 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur en Allemagne ; CJCE 8 octobre1996, Dillenhofer ;
[3] CE, assemblée, 28 février 1992, Société Arizona Tobacco Products ;
[4] CE, assemblée, 22 décembre 1978, Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit ;
[5] Il acceptait en revanche que tout justiciable puisse demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives. De même, s’agissant des décisions administratives, il était possible de faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis pour la transposition d’une directive, les autorités nationales ne pouvaient ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application de règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives.
[6] Tout justiciable peut directement se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre des actes administratifs non réglementaires, des dispositions d’une directive non transposée, à la double condition que les délais de transposition soient expirés et que les dispositions invoquées soient précises et inconditionnelles.
[7] CE assemblée 24 décembre 2019, n°425983, Sté hôtelière Paris Eiffel Suffren, Lebon. Voir aussi, s’agissant du droit de l’Union européenne, CE 23 juillet 2014, Sociétés d’édition et de protection route, AJDA 2014, 2358, note Boyelle ;
[8] CAA Versailles, 17 juillet 2023, n°22VE00442. Cette décision n’est pas la première. Déjà en 2016, le tribunal administratif de Clermont Ferrand avait condamné l’Etat à indemniser un salarié qui réclamait le paiement de congés payés acquis pendant une période d’arrêt de travail. Cf. TA Clermont Ferrand 6 avril 2016, n°1500608 ;
[9] Déclaration de M. Huglo lors d’une conférence coorganisée par l’université Paris 1 et l’Association française de droit du travail et de la sécurité sociale (AFDT) le 12 octobre 2023.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.