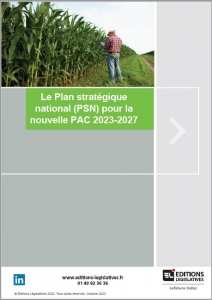Devoir de vigilance, la porte se referme
16.07.2023
Gestion d'entreprise

Le 6 juillet, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'action intentée par des ONG et des collectivités à l'encontre de TotalEnergies pour manquement à son devoir de vigilance en matière climatique. Jean-Baptiste Barbièri, maître de conférences à l'Université Paris-Panthéon-Assas et Antoine Touzain, professeur agrégé à l'Université Rouen Normandie nous expliquent les raisons pour lesquelles le juge de la mise en état a déclaré l'ensemble des demandes irrecevables.
Le 5 juillet, un funeste record a été battu : celui de la journée la plus chaude au niveau mondial (moyenne à 17,18° C). Le record précédent datait de la veille, 4 juillet (17,01° C), qui avait largement éclipsé le précédent record de 16,92° C des 14 août 2016 et 24 juillet 2022. Mais un autre coup de chaud devait survenir le lendemain, avec l’ordonnance de mise en état rendue dans l’affaire Total Énergies.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Disons-le d’emblée : ce jugement est très discutable et n’est pas à la hauteur des enjeux climatiques. Quoi qu’on puisse penser du fond du litige, l’irrecevabilité qui est prononcée par le juge, pour des motifs qui ont pu être déjà largement critiqués par la doctrine dans les affaires précédentes, saisit le commentateur d’une certaine lassitude. Autre coïncidence de calendrier, qui rend la décision peu compréhensible : elle a été rendue le lendemain d’un colloque qui fera date, laissant augurer d’un dialogue fructueux entre les juridictions et la doctrine, et à l’occasion duquel nombre d’arguments développés ci-après ont été assénés par plusieurs intervenants. Puisqu’il faut garder espoir, gageons que les futures décisions en matière de plan de vigilance entendront les critiques.
De quoi était-il question en l’espèce ? Plusieurs associations et communes avaient, en janvier 2020, assigné la société TotalEnergies devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article L. 225-102-4, I et II, du code de commerce, aux fins de lui faire publier un plan de vigilance identifiant clairement les risques résultant de son activité – contribution aux émissions globales de gaz à effet de serre (GES) à hauteur de 1 %, poursuite de projets d’exploration de nouveaux gisements d’hydrocarbures, contribution à l’épuisement du budget carbone mondial disponible et poursuite de projets d’exploitation pétrolière et gazière, utilisation de technologies de captage et stockage de CO2 – afin que soit établie une cartographie complète et exhaustive des risques ainsi qu’une analyse et une hiérarchisation de chacun de ceux-ci.
Les requérants demandaient en outre la condamnation de Total à inscrire dans son plan de vigilance des mesures adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, avec des objectifs chiffrés d’alignement sur une trajectoire d’émission de GES compatible avec la limite de 1,5° C et afin d’atteindre la neutralité carbone, proposant de tels objectifs ou, à tout le moins, que la défenderesse en fixe d’elle-même, qui soient compatibles avec les propositions faites, notamment, par le GIEC. Par ailleurs, les demandeurs se fondaient sur l’article 1252 du code civil, pour faire condamner la défenderesse à « publier et mettre en œuvre » des actions de réduction d’émissions directes et indirectes de GES, répétant à ce titre les objectifs invoqués au titre des demandes fondées sur le devoir de vigilance.
En défense, la société TotalEnergies invoqua le totem d’immunité désormais habituel : le défaut de mise en demeure à contenu identique à l’assignation finalement délivrée. Elle y ajoutait d’autres arguments (dont certains ne manquent d’ailleurs pas de pertinence), tenant à l’extinction de l’instance en raison de la disparition de l’objet de l’action (puisque de nouveaux plans de vigilance avaient été établis depuis), ainsi qu’au défaut de qualité à agir de certaines associations demanderesses – faute d’avoir une ancienneté suffisante – et des communes – en ce que le préjudice invoqué ne concernerait pas uniquement leur territoire mais le monde entier.
Le juge de la mise en état (JME) donne raison à la défenderesse, en déclarant l’ensemble des demandeurs irrecevables. On dira quelques mots rapides concernant les aspects procéduraux de l’ordonnance avant d’envisager plus longuement les aspects substantiels.
Le JME se prononce tant sur sa compétence que sur la qualité à agir des requérants.
Compétence du JME
Il est vrai qu’une telle compétence découle de l’article 789 du code de procédure civile, qui prévoit qu’il revient au JME de « statuer sur les fins de non-recevoir », ce qui peut impliquer qu’il ait connaissance d’une éventuelle « question de fond » dont dépendrait l’irrecevabilité, sauf opposition d’une partie. Or, en l’occurrence, les demandeurs s’y opposaient : le dessaisissement était donc de droit, à supposer que le débat portât sur une question de fond.
En l’occurrence, les demandeurs considéraient que le débat sur la qualification de fin de non-recevoir de la mise en demeure requise par l’article L. 225-102-4 du code de commerce était une question de fond. Le JME estime que tel n’est pas le cas, sans aucunement motiver sa décision. La solution n’a pas pourtant rien d’évident : ainsi qu’on y reviendra, la qualification de fin de non-recevoir est éminemment discutable. De même, le dessaisissement aurait pu concerner la qualité à agir, dont la vérification nous paraît devoir justifier un examen au fond.
Qualité à agir des requérants
Dans un obiter dictum (décidément à la mode en matière de devoir de vigilance), le JME, après avoir déclaré les demandeurs irrecevables pour défaut de mise en demeure préalable, apporte, « de manière surabondante », d’utiles précisions sur la qualité à agir. Pour ce faire, le JME se réfère à l’article 1248 du code civil, qui encadre les titulaires de « l’action en réparation du préjudice écologique ».
Quant aux associations « ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement », le texte exige qu’elles aient été créées ou agréées « depuis au moins cinq ans à la date de l’introduction de l’instance ». C’est le critère que retient le JME, en l’occurrence pour déclarer irrecevables les demandes de certaines associations demanderesses.
Quant aux communes, le même article n’ouvre l’action qu’aux « collectivités territoriales […] dont le territoire est concerné ». Pour le JME, cela suffit à écarter l’action des communes demanderesses, dès lors que « le préjudice écologique dont elles se prévalent concerne non seulement leur territoire mais le monde entier », car admettre une telle action « signifierait que n’importe quelle collectivité locale dans le monde » pourrait agir. Si l’argument s’entend (il s’agit d’éviter une actio popularis incontrôlée), il est réversible, car il peut conduire au résultat inverse, à savoir l’impossibilité systématique, pour les communes, d’agir sur ce fondement (sauf les cas de préjudice causé directement par une société au territoire de la commune, par exemple en cas de pollution des sols ; mais cela suffit-il alors que le dérèglement climatique présente un caractère systémique ?).
On rappellera que le juge administratif est moins frileux : s’il refuse l’action des particuliers, il admet celle des communes contre l’État s’il est constaté le « caractère inéluctable des conséquences du changement climatique en l’absence de mesures efficaces prises rapidement pour en prévenir les causes ». Pourquoi ne pas retenir la recevabilité pour les actions contre des sociétés selon le même critère ?
Quoi qu’il en soit, il est piquant que l’article 1248 du code civil soit ainsi mobilisé par le JME, dès lors qu’il décide par ailleurs que les textes du code de commerce excluent le jeu du droit commun… C’est envisager les aspects substantiels.
Deux aspects doivent être évoqués : l’irritante question de la mise en demeure et l’articulation entre les articles L. 225-102-4 du code de commerce et 1252 du code civil.
La mise en demeure
Concernant le défaut de mise en demeure, ce n’est pas faute d’avoir critiqué cette solution auparavant. Le juge énonce ici – reprenant le raisonnement habituel – que « le législateur a voulu que tout contentieux relatif au devoir de vigilance donne lieu, avant la saisine de la justice, à une discussion entre les parties », alors que ce législateur a simplement voulu que ce plan soit « élaboré en association avec les parties prenantes ». Les parties prenantes ne sont pas les parties au litige et la phase de l’élaboration du plan n’est pas celle du contentieux, de sorte, répétons-le encore et encore, qu’il faut abandonner cette solution.
Surtout, même à admettre, de façon discutable, que la mise en demeure préalable soit exigée dans une logique de conciliation, les demandeurs invoquaient que ce « dialogue » avait ici été respecté puisque des réunions s’étaient tenues entre les associations et la société Total. Malgré cette tentative de conciliation préalable, le juge répond que « le législateur a voulu que la personne redevable du devoir de vigilance soit solennellement avertie avant de faire l’objet d’une action en justice. Or, de simples réunions ne peuvent constituer un avertissement solennel ».
La mise en demeure a pour acception traditionnelle la sommation faite au débiteur de s’exécuter, mais peut aussi être vue comme un moyen d’entrer dans une phase de dialogue. Certes, rien n’interdit de mélanger les deux : je somme de faire et je veux entrer en discussion pour aboutir à l’exécution, et l’on voit bien que la conciliation obligatoire et préalable avant tout litige répond à cette logique.
Le juge est ici entre deux eaux, car il semble considérer que la mise en demeure n’est pas valable et que les discussions préalables ne peuvent pallier cela. L’objectif affiché de dialogue s’efface alors bien vite…
Pourquoi en ce cas la mise en demeure ne constitue-t-elle pas une interpellation suffisante en l’espèce ? Le grief principal qui lui est fait est qu’elle serait imprécise car contenant la phrase « sans préjudice des autres mesures qui pourront être identifiées » en sus de mesures énumérées. L’argument surprend : si des mesures trop précises étaient demandées, sans alternative possible, le juge ne se refuserait-il pas à les imposer, au prétexte de l’exigence de non-immixtion dans la direction de la société ?
Le juge mêle également à cela des considérations tenant à l’assignation ; là encore on sait que, jusqu’à présent, les juridictions imposent que l’assignation et la mise en demeure ne diffèrent pas, ce qui aboutit à ce que la mise en demeure et l’assignation doivent porter sur le même plan. Il va ici plus loin considérant qu’« il n’est pas concevable de saisir le tribunal afin d’obtenir un plan comportant des objectifs chiffrés qui ne figurent pas dans la mise en demeure et n’ont donc pas pu être discutés au préalable ». Or les demandeurs avaient introduit de telles demandes dans leur assignation et se défendaient en considérant que « les demandes formulées dans l’assignation correspondent à l’esprit dans lequel la mise en demeure a été délivrée ».
Qu’en retenir ? Que la mise en demeure :
- ne doit pas contenir de formule telle que « toute autre mesure » ;
- doit présenter les mêmes objectifs chiffrés que l’assignation ; de manière générale elles doivent présenter une extrême similitude, voire une gémellité ;
- si elle est insuffisante, ne peut être palliée par des discussions.
Tout ceci est (trop) sévère. On ne peut raisonnablement être extrêmement formel sur cette mise en demeure tout en considérant qu’en réalité elle doit concilier les parties. Rappelons là encore que cette identité entre mise en demeure et assignation constitue une porte de sortie incroyable offerte aux entreprises qui auront beau jeu de changer leur plan entre l’une et l’autre, tirant ainsi profit de ce formalisme excessif prétorien, au détriment des finalités poursuivies par les plans de vigilance.
L’articulation des textes
Le défendeur arguait que l’invocation de l’article 1252 du code civil était faite dans le but de contourner la mise en demeure de l’article L. 225-102-4 du code de commerce. Il est vrai que les demandes spécifiques fondées sur ces deux articles étaient formellement identiques. Le juge se laisse convaincre et considère que « ces deux demandes poursuivent le même objectif » et qu’il n’y a « aucune différence » entre les deux. Ainsi, « la demande formulée sur le fondement de l’article 1252 du code civil est en réalité soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui sont spéciales et dérogent aux dispositions d’ordre général du code civil ». Cette demande, fondée sur l’article 1252 du code civil a alors « manifestement été faite en vue de contourner l’obligation de mise en demeure prévue au paragraphe II de l’article L. 225-102-4 du code de commerce ».
Il y aurait beaucoup à dire sur cette motivation. L’injonction de se mettre en conformité avec les obligations de l’article L. 225-102-4, I, du code de commerce est effectivement spéciale (c’est le II du texte). Néanmoins, l’article L. 225-102-5 du code de commerce prévoit, pour l’établissement du plan, un régime de responsabilité fondé sur le droit commun des articles 1240 et 1241 du code civil, ce qui met à mal l’idée d’un rapport de spécialité entre ces textes commerciaux et le droit commun de la responsabilité civile. De surcroît, quand bien même ce serait le cas, cela n’empêcherait pas de les appliquer conjointement dès lors qu’ils ne sont pas antinomiques, comme c’est le cas ici.
Mais peu importe, le juge considère en l’espèce qu’il n’y a pas d’autre voie que celle de l’article L. 225-102-4, II, du code de commerce pour forcer une entreprise à honorer ses obligations tirées du I. Or il est selon nous tout à fait possible de faire cesser l’illicite que serait l’absence de publication du plan sur le fondement de l’article L. 225-102-5 du code de commerce renvoyant aux articles 1240 et 1241 du code civil lesquels n’excluent pas le jeu de l’article 1252 du code civil (même si ce dernier article deviendrait alors un peu superfétatoire, la cessation de l’illicite étant fondée sur la clause générale de responsabilité du fait personnel).
La conception selon laquelle seul l’article L. 225-102-4, II, du code de commerce fonderait une action tendant à la mise en conformité (l’injonction) aux obligations du I nous semble donc réductrice.
Retenons également que les demandes fondées sur l’article 1252 du code sivil ne portaient pas sur l’insertion dans un plan de certains objectifs mais sur la publication et la mise en œuvre de l’obligation de prévention des dommages résultant de ces activités, qui ne ressortit pas exclusivement de l’article L. 225-102-4, II, du code de commerce. Dit autrement, il n’était pas exactement demandé la même chose : dans un cas la modification du plan, dans l’autre, la publication et la mise en œuvre de l’obligation de prévention, même si les demandes au sein de ces deux catégories étaient identiques.
Le JME refuse pourtant de distinguer : est-ce à dire qu’il considère que l’article L. 225-102-4 du code de commerce est spécial dans son intégralité et que l’on ne pourrait reprocher aux entreprises leur défaut de vigilance sur le fondement du droit commun ? Cela serait parfaitement discutable et contredirait la logique formelle des textes spéciaux, qui ne devraient pas empêcher le jeu du droit commun et de sa logique substantielle.
Nous considérons en effet que les entreprises sont tenues d’un devoir de vigilance général, dont une des obligations spéciales tient à la publication et à la mise en œuvre d’un plan de vigilance, formalisé par l’article L. 225-102-4 du code de commerce. Dans ces conditions, une demande tendant à faire cesser l’illicite que représenterait l’absence de vigilance de l’entreprise et la prise de mesures pour y remédier, pourrait être fondée sur l’article 1240 ou l’article 1241 du code civil ou, s’agissant de la réparation spécifique d’un préjudice écologique, sur l’article 1252 du code civil.
Tout au plus pourrait-on considérer qu’une demande fondée sur l’un de ces deux articles et qui aurait un objet strictement identique à l’action en injonction de l’article L. 225-102-4 du code de commerce pourrait être neutralisée. Ce n’était pas le cas en l’espèce étant donné que la demande fondée sur l’article 1252 du code civil ne cherchait pas à modifier le plan.
En guise de conclusion, il faut espérer que la ligne actuellement à l’œuvre au Tribunal judiciaire de Paris soit rompue. La double tendance à faire de la vigilance un devoir purement formel, tout en l’étendant au prix d’une disparition du droit commun (dénoncée en son temps comme une tendance régressive par Oppetit), ne saurait convaincre. Le risque est, avec les discussions actuellement en cours au niveau européen, que le juge judiciaire se retrouve purement et simplement dessaisi au profit d’une autorité administrative spécialement dédiée. Tel est le danger : celui de la disparition de toute justice climatique.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.