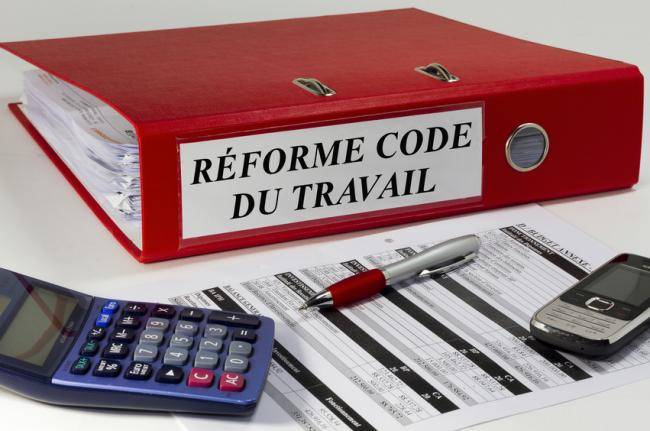Alors que le gouvernement dévoile aujourd’hui son projet de loi d’habilitation pour réformer le code du travail, les DRH prennent la parole. Si la plupart sont partisans d’une négociation renforcée au sein de l’entreprise et d'une simplification des IRP, les avis divergent sur l’extension du CDI de projet et le barème des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Après les lois Rebsamen, Macron et El Khomri, les DRH sont-ils prêts à affronter une nouvelle salve de réformes sociales ? Si Alain Everbecq, DRH du groupe Poclain, estime "qu’il aurait été nécessaire de faire une pause pour s’approprier le droit existant", la plupart des professionnels RH s'en réjouissent. "On a besoin d’adapter le code du travail au monde de demain", soutient Jérôme Barré, DRH du groupe Orange. Car si les dispositifs précédents semblent "aller dans le bon sens", les lois de 2015 et 2016 montrent aussi leurs limites. "Le vrai problème de la loi El Khomri, c’est qu’il n’y a pas eu de choc de changement pour se mettre à niveau des pays anglo-saxons", renchérit Francis Bergeron, DRH France du groupe SGS, leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification (90 000 salariés). Tous ne souhaitent pas pour autant chambouler les mesures à l’œuvre actuellement. "L'exception culturelle française mérite de préserver un droit protecteur tout en sortant de ce carcan réglementaire qui n'est pas favorable à l'employabilité des salariés", nuance Christophe Foglio, DRH de M6.
Dans le détail, la plupart des DRH sont partisans d’une extension de la primauté de l’accord d’entreprise majoritaire, prévue par les ordonnances, au-delà des congés et de la durée du travail. Cette approche de la négociation in situ est d’ailleurs perçue comme innovante pour 79% des dirigeants d'entreprise et des décideurs RH, selon l'étude dévoilée, le 26 juin, par le cabinet d’avocats d’affaires Fidal et le cabinet de conseil en management Amplitude. Même si la plupart concède qu’elle est "complexe à mettre en œuvre".
En effet, "il ne s’agit pas de donner un blanc-seing au dirigeant de l’entreprise, insistait, mi juin, Jean-Paul Charlez, président de l’ANDRH lors de la présentation des propositions de l'association, en marge de la concertation des partenaires sociaux. Mais d’obtenir un accord majoritaire signé par des syndicats ayant recueilli plus de 50% des suffrages ou à défaut validés par une majorité de salariés". Reste que pour l’association, certains domaines doivent rester interdits à la négociation d’entreprise, "comme le contrat de travail, les périodes d’essai, par exemple". Ils renvoient donc à la branche professionnelle le soin de "prévoir la durée et les motifs de recours du contrat de travail", selon le cabinet Fidal. Objectif affiché ? "Adapter au mieux le contrat à leur secteur d’activité".
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Les dirigeants d’entreprise et les décideurs RH attendent aussi une simplification de la représentation du personnel (75 %), selon ce dernier sondage. Leur souhait ? La création d’un conseil d’entreprise pour remplacer les DP, CE et CHSCT, doté d’un pouvoir de négociation. Ce serait donc au niveau de ce conseil d’entreprise que seraient négociés et conclus les accords d’entreprise. "La création d’un tel conseil en lieu et place de plusieurs instances constituerait un pas certain vers une plus grande simplification des relations sociales", relève Francis Bergeron. Quitte à ce que celles-ci ne relèvent plus des seules organisations syndicales mais d’une représentation élue par le personnel. Selon l’étude, cette simplification de la représentation du personnel est même "la pierre angulaire qui conditionnera le succès ou non de la réforme du droit du travail". Mais, les DRH préviennent : "si l’instance unique ne peut pas conclure d’accord collectif majoritaire, les attentes pourraient être déçues".
Sur le front des contrats de travail, Christophe Foglio constate que "le CDI à temps partiel mériterait d'être plus souple". La raison ? La difficulté de faire moduler le temps de travail en fonction des pics d’activité fréquents dans la production audiovisuelle ; les équipes travaillant souvent en mode projet. "Ce contrat doit, en effet, spécifier les horaires et les jours de travail de façon pérenne dans le contrat de travail. Toute modification entraîne des avenants et, par conséquent, un temps administratif sans aucune valeur ajoutée pour les équipes RH". Cette souplesse pourrait également "satisfaire les salariés qui souhaitent partager leur temps de travail entre deux employeurs. Un cas fréquent dans les métiers de production et artistiques liés aux médias".
Le projet du gouvernement de favoriser le d��veloppement de contrats à objet défini, expirant à la fin d’un chantier ou d’une mission, divise les professionnels RH. Alain Everbecq n'en voit pas l'intérêt car ce type de contrat peut entraîner "des effets pervers". "On ne peut pas laisser vivre en permanence des personnes sous ce statut-là, indique-t-il. Pour atteindre le même objectif, il suffirait de simplifier les règles générales du licenciement". De même, Louis Aubé, DRH de Dolead, une société spécialisée dans les campagnes publicitaires sur Internet, n’est pas favorable à ce type de contrat. "Le CDI doit rester la règle", affirme-t-il. Cette entreprise de 35 salariés, en pleine croissance, compte, en effet, "sur ce statut pour être attractive et faire la différence auprès des informaticiens sursollicités".
A contrario, Francis Bergeron attend des assouplissements de ce contrat bien adapté "aux équipes informatiques qui travaillent par projet, notamment la possibilité de le renouveler ; la durée d’une mission dépassant bien souvent le timing initialement prévu". Une quinzaine de salariés ont été embauchés, l'an dernier, au sein du groupe SGS en CDI de projet pour des missions comprises entre 18 et 36 mois.
Autre point de divergence : l’instauration d’un barème obligatoire pour les indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette mesure recueille l’aval de Philippe Lamblin, DRH du groupe Avril. D’une part, parce qu’elle "éviterait le versement d’indemnités trop importantes" qualifiées par le DRH de "disproportionnées". D’autre part, parce que "les montants seraient homogénéisés sur le territoire quel que soit le conseil des prud’hommes". Ce qui éviterait "une inégalité de traitement entre deux personnes".
De même, Christophe Foglio reconnaît que ce barème permettrait de "lever les incertitudes liées au coût du licenciement". "L’employeur et particulièrement les PME et les TPE pourraient alors évaluer et provisionner le risque financier dans l'hypothèse de licenciements". Une anticipation qui aurait "peut-être la vertu de désengorger les tribunaux prudhomaux et par répercussion les cours d'appels, permettant ainsi un traitement plus rapide des contentieux".
A contrario, Alain Everbecq craint que cette mesure "qui part d'une bonne intention ne devienne un nid à contentieux, la plupart des avocats tentant d’exclure de ce barème le licenciement en plaidant une cause de discrimination ou de harcèlement". D’où des interprétations très différentes.
Entre ces deux positions, l’ANDRH préconise "la mise en place d'une fourchette avec un plafond et un plancher, déconnectée des critères d'âge et d'ancienneté, afin de laisser aux juges le pouvoir d'apprécier le préjudice subi et le montant des dommages et intérêts à verser".
C��té licenciement économique, Francis Bergeron souhaite que le gouvernement retienne le périmètre non pas européen mais national pour l’appréciation du motif économique. C’est-à-dire que la situation économique de l’entreprise ne soit plus évaluée au niveau international mais uniquement français. "C’est quelque chose que j’ai vécu très souvent : on ferme une agence pour des raisons locales, dues, par exemple, à la réorganisation d'un client ou à des changements dans la réglementation du pays. On nous demande d'apporter la preuve que cette décision correspond bien à une nécessité de maintien ou de redressement de la compétitivité au niveau de la branche. Or, dans un groupe de notre taille (2 000 bureaux et laboratoires dans le monde), la fermeture d'un centre d'essais cliniques (par exemple) n'altère pas vraiment, fort heureusement, la compétitivité de la branche dédiée, appréciée au niveau mondial".
Francis Bergeron milite également "pour des mesures de reclassement plus réalistes"; l’employeur devant jusqu’à présent rechercher toutes les solutions possibles pour ne pas licencier le salarié et donc tout mettre en oeuvre pour le reclasser. Y compris dans les filiales étrangères si le salarié en exprime le souhait. "Pour un groupe comme le nôtre, implanté dans 140 pays, il est impossible d'apporter la preuve (et même de vérifier) qu'il n'y aurait pas en interne, quelque part dans le monde, un poste correspondant au niveau et aux compétences de notre collaborateur".
Enfin, le projet de simplifier les obligations de déclaration des expositions retient l’attention des professionnels RH. "La mise en œuvre de ce compte créée des contraintes trop fortes, confirme Francis Bergeron. Car, en pratique, il est, par exemple, très difficile de définir le nombre de personnes et d’heures concernés par le travail de nuit en raison des multiples rotations d'équipes".
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.