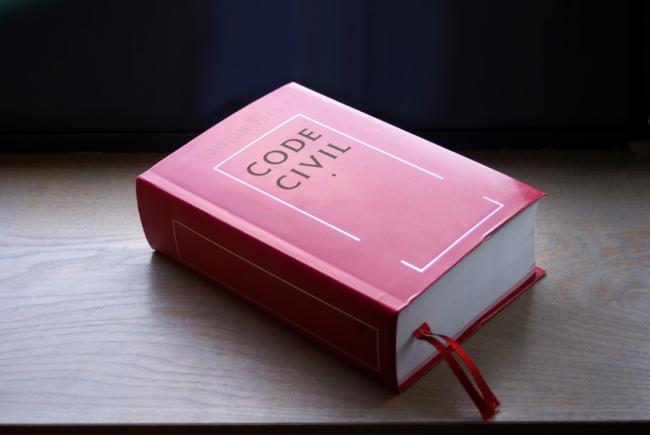Au 1ᵉʳ octobre 2016, le droit des contrats sera modernisé. La Chancellerie a modifié son projet initial sur les questions de l’entrée des clauses abusives au sein du code napoléonien, mais aussi du devoir général d’information, de la théorie de la violence économique et de l’imprévision.
Le calendrier aura été respecté. L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée hier au Journal Officiel. Il restait 5 jours à la Chancellerie pour procéder à la modernisation du droit des contrats en usant de l’habilitation législative dont elle disposait depuis la loi adoptée un an auparavant, le 16 février 2015.
Dans ses grandes lignes, l’ordonnance reste fidèle aux évolutions de concepts, reprises de notions issues d’autres codes et aux innovations juridiques présentées dans l’avant-projet soumis à consultation par la Chancellerie fin février 2015 (voir notre article). Mais elle a su faire évoluer sa copie, sur la base - sans doute - des nombreuses contributions reçues lors de la consultation (voir notre article). Première présentation des différents points sensibles de la réforme.
La disparition de la cause, l’élargissement de la notion de bonne foi - de la formation à l’exécution du contrat (voir l’article 1103) - et l’affirmation de la liberté contractuelle au frontispice du code civil, sont maintenus dans l’ordonnance publiée hier.
L’abandon de la cause avait pourtant suscité débat, mais la Chancellerie aura maintenu sa position. A noter que si le mot ne figure plus dans le code civil, le concept n’est pas entièrement renié. Ainsi, est nécessaire à la validité d’un contrat que son contenu soit licite, précise l’article 1128 du code. De même, le contrat devra toujours reposer sur la nécessité d’une contrepartie (voir l’article 1169) et avoir une cause licite (article 1162).
Concernant l’affirmation de la liberté contractuelle, aux sein des dispositions liminaires, la méthode est saluée par les praticiens (voir l’article 1102 du code civil). « C’est fondamental, cela met le France sur la même ligne que d’autres pays », estime Maurice Bensadoun*, administrateur à l’AFJE (Association française des juristes d’entreprise) et animateur du groupe de travail ad hoc sur le projet de réforme. Dans sa version finale, la seule limite opposée à cette liberté se concentre dans « les règles qui intéressent l’ordre public ». L’avant-projet mentionnait également les droits et libertés fondamentaux auxquels il n’était pas possible de déroger par le contrat. La réécriture de l’article porte-t-elle à conséquences ? Non selon Bruno Dondero, professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. « Le fait de viser l’ordre public implique les droits et libertés fondamentaux », analyse-t-il. Pour lui aussi, il y a « une belle affirmation de la liberté contractuelle ».
Élément du code civil, que l’avant-projet avait écarté, mais qui a finalement fait son retour, celui de l’articulation entre règles générales et spéciales. L’article 1105 précise ainsi que « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du [code civil]. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières ». L’AFJE avait demandé que cette précision soit énoncée par le code civil. Content d’avoir vu accéder la demande de l’association, Maurice Bensadoun déclare : « Avec cela on règle tout ».
Cette notion a son importance, notamment dans le cadre de l’insertion de la théorie des clauses abusives au sein du code civil (voir l’article 1171). Car l’interdiction des clauses abusives est également énoncée à l’article L.132-1 du code de la consommation et à l’article L.442-6, I, 2 du code de commerce, faut-il le rappeler (voir notre article). Au-delà, la référence aux clauses abusives dans le code civil a été rétrécie, elle est désormais limitée aux seuls contrats d’adhésion également définis par le code (voir l’article 1110). C’est un autre point sur lequel l’AFJE avait fait son lobbying.
Néanmoins, pour l’avocat Joseph Vogel*, limiter les clauses abusives aux contrats d’adhésion ne préjuge en rien que soit écarté le code civil dans les relations B to B. Car en matière de distribution, les contrats d’adhésion peuvent être « efficaces », estime-t-il. L’existence de deux régimes différents, celui du code civil et celui de l’article L.442-6 serait donc « un nid à contentieux ». C’est « la disposition la plus grave du texte », poursuit-il.
L’ordonnance introduit également un devoir général d’information (voir l’article 1112-1). Présenté par l’avant-projet, sa portée avait été jugée trop générale (voir notre article). Il est désormais mieux défini puisqu’il identifie les informations soumises à cette obligation que le co-contractant doit délivrer à l’autre. L’AFJE avait plaidé pour qu’il ne s’applique pas dans les rapports entre professionnels ou qu’il soit d’ordre supplétif. Sur ce point, elle n’a pas été entendue. Le code civil précise que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». Le non-respect de ce devoir engage la responsabilité de celui qui en était tenu ou l’annulation du contrat. « Il va falloir faire en sorte de ménager les preuves, de documenter le fait d'avoir informé », analyse Joseph Vogel.
Autre point qui a suscité de nombreuses critiques (voir notre article), celui de l’apparition de la théorie de violence économique en tant que vice du consentement (voir article 1142). Là encore, le texte final a évolué par rapport à l’initial. La violence économique n’est plus consacrée en cas d’abus de nécessité et ne fait plus référence à la faiblesse du co-contractant. Elle ne pourra être admise qu’en cas « d’abus de l’état de dépendance de son partenaire commercial », état dont il faudra avoir tiré « un avantage manifestement excessif », introduit encore le texte. Pour Bruno Dondero, la violence « est ainsi bien encadrée ». Ce qui n’est pas l’avis de Joseph Vogel. Il voit des limites à l’émergence de ce concept, notamment dans le domaine de la grande distribution.
Enfin, l’ordonnance a conservé l’imprévision (voir article 1195). Là encore, le pouvoir accordé au juge pour mettre fin à un contrat « en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat » rendant son exécution « excessivement onéreuse », était largement dénoncé par les praticiens (voir notre article). Une révision du libellé de l’article a donc été opérée par la Chancellerie. Dans le cas où les parties ne seraient pas d’accord pour renégocier le contrat elles pourraient, tout d’abord, « convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent », puis, demander au juge d’intervenir. En cas de déclenchement de cette seconde étape, le juge pourrait alors choisir de réviser le contrat et plus uniquement d’y mettre fin. Deux ajouts ont donc été insérés. Pourtant, ce qui continue de « gêner » Maurice Bensadoun, c’est « l’intervention du juge dans le contrat. Nous n’avons pas besoin du juge ». Les professeurs de droit, eux, s’accordent à dire qu’il sera, toutefois, possible d’écarter cette notion par le contrat lui-même, l’imprévision n’étant pas d’ordre public.
La technique de rédaction contractuelle s’enrichirait donc avec ce nouveau code civil. « Le terrain pourra être déminé en faisant appel à des juristes compétents pour rédiger les contrats ». Car nombreuses sont les dispositions du code d’ordre supplétif et plus rares sont celles d’ordre public, estime l’administrateur de l’AFJE. Selon Bruno Dondero, hormis celles énoncées comme étant d’ordre public, telles que le devoir général d’information (vu plus haut), ou les différents vices du consentement auxquels il paraît difficile de déroger, c’est avant tout la jurisprudence qui fournira une interprétation en la matière. Il relève cependant que le rapport au Président de la République, qui accompagne l'ordonnance, confirme que l'ordonnance est supplétive sauf disposition contraire. Joseph Vogel, lui, conclut par ces mots : « il faut se dépêcher de conclure les contrats importants avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi »…
|
Entrée en vigueur de la réforme • L’ordonnance précise que ses dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2016. • Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. • Quelle est la loi applicable aux contrats renouvelés : les dispositions actuelles ou à venir du code civil ? Selon Bruno Dondero, « un contrat renouvelé est un nouveau contrat, ainsi soumis à la loi nouvelle ». • Et si les parties cherchent à proroger le contrat conclu sous l’ancien régime ? Proroger la durée d’un contrat sans modification pourrait permettre de conserver le bénéfice de l’ancien régime. Attention toutefois à la fraude, met en garde le professeur. |
|---|
* Propos recueillis lors d’un petit-déjeuner organisé par le cabinet Vogel&Vogel et l’AFJE hier matin.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.