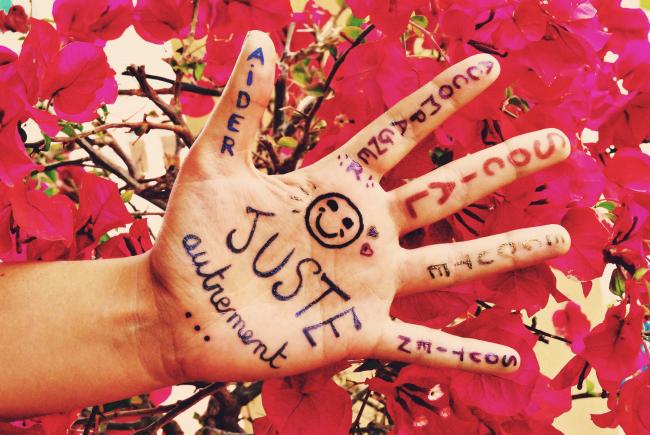Après dix années passées en institution, avec son lot de frustrations et l’impression de s’épuiser, Aurélie Bonnin a fait le pari de se lancer comme assistante sociale en libéral. Elle a construit une offre originale, qui lui donne le sentiment d’exercer en conformité avec ses idéaux professionnels et ses goûts personnels. Si son activité a démarré de façon encourageante, elle regrette que ce choix du libéral soit parfois si mal compris par sa profession. Elle évoque ici le sens qu’elle met à son positionnement et encourage ses pairs à se laisser tenter.
Quelles expériences institutionnelles vous ont conduite à faire le choix du libéral ?
Je ne me suis jamais sentie vraiment épanouie durant les dix années que j’ai passées en institution. Je trouvais difficile de vivre le décalage entre l’idéal professionnel avec lequel j’avais démarré mes études et la réalité du terrain. J’ai commencé en polyvalence de secteur, sur une zone géographique rurale, assez large, où on m’imposait des entretiens de 30 minutes maximum, alors que j’avais appris en formation à fonctionner sur une durée de 45 à 60 minutes. J’ai fini par prendre la décision d’augmenter la durée de mes entretiens, mais cela a naturellement eu pour conséquence d’accroître mes délais de rendez-vous. Comme je m’impliquais aussi dans des visites à domicile, parce que cela me semblait nécessaire, j’ai très vite manqué cruellement de temps, et au bout d’un an j’ai compris que je ne ferais pas long feu dans ces conditions. Par la suite, j’ai essayé de trouver des solutions à mon insatisfaction en changeant d’institution – j’ai travaillé en clinique privée, en maison de retraite, à l’hôpital – et même en me mettant à mi-temps. Malgré le plaisir que j’ai toujours pris à travailler en équipe, avec des collègues agréables et soutenants, je n’ai cessé de me heurter au peu de place accordée aux travailleurs sociaux, à l’insuffisance de leurs moyens et à des missions qui ne faisaient pas sens pour moi. Mes collègues et moi-même nous rejoignions d’ailleurs régulièrement sur ces questions.
Qu’est-ce qui a déclenché votre décision de quitter l’institution ?
C’est un projet parental, qui m’a permis de prendre du recul. Je me suis dit que tout allait bien dans ma vie et que c’était le bon moment de me lancer. Je me suis autorisée à démissionner. Mon idée était de créer une activité plus proche de mon idéal : celui de consacrer du temps aux personnes, et de les accueillir dans leur globalité, c’est-à-dire en se donnant la possibilité de parler aussi bien des conflits familiaux que des questions financières ou des problématiques de santé. Je savais que nous n’étions pas nombreux sur ce créneau, mais je me suis renseignée sur l’existant et j’ai réfléchi au projet qui ferait sens pour moi. C’est comme ça que « La plume sociale » a ouvert l’année dernière. J’y propose des rendez-vous à distance, pour permettre à ceux qui vivent dans des endroits reculés de bénéficier de l’aide dont ils ont besoin. Mon approche comporte trois axes : de l’accompagnement social classique, un travail sur l’émotionnel et une aide complémentaire autour de l’écriture.
Pourquoi cet accent sur l’écriture ?
D’abord par goût : j’aime beaucoup écrire et cela m’apporte beaucoup dans ma vie personnelle. Je me suis également formé aux écrits professionnels dans le travail social. Enfin, dans les maisons de retraite où j’ai exercé, j’ai rencontré beaucoup de personnes âgées isolées qui venaient dans mon bureau pour parler de leur vie passée. J’avais le sentiment d’être une personne de référence pour elle et que le travail de récit de vie que nous nous sommes mises à faire ensemble par écrit les redynamisait. Au moment où j’ai monté mon activité, j’ai donc souhaité réutiliser cette approche en direction des seniors. Je me rends compte aujourd’hui que des publics plus jeunes me contactent via mon site internet, pour bénéficier de cette aide à l’écriture. Je réfléchis donc à faire évoluer mon offre.
Et cet accompagnement émotionnel, comment le qualifieriez-vous ?
Je propose aux personnes âgées une permanence d’écoute et de soutien. C’est un outil de lutte contre l’isolement. Je leur propose d’aborder aussi bien des thématiques graves – isolement, veuvage, peur de la mort, perte d’un proche… – que d’autres plus légères qu’elles voudraient partager. Il s’agit d’un soutien sans vocation thérapeutique, même si j’ai des notions de psychologie et que je me forme en permanence sur ce sujet. Lorsque je sens que j’arrive aux limites de mon intervention, j’oriente si besoin vers un psychologue.
Votre offre a-t-elle rapidement pris ?
Oui, une première personne m’a contactée au bout de quinze jours, et j’ai connu une rapide montée en charge des demandes, avec une majorité de jeunes seniors, mais aussi des étudiants, pour lesquels j’ai réservé une entrée spécifique sur mon site
Pour quelle raison ?
Quand je travaillais en institution, j’avais beaucoup apprécié d’accompagner des étudiants dans leurs stages. Je ne voulais pas me couper de cette activité, et j’ai décidé de proposer une offre aux étudiants en travail social – au-delà des seuls assistants sociaux – car ils ont souvent besoin d’être rassurés, accompagnés de façon individuelle sur leur situation, de pouvoir échanger sur le déroulement de leurs études et leurs débouchés, de prendre confiance.
Quel accueil votre activité reçoit-elle auprès des professionnels du social ?
J’ai reçu des appels de travailleurs sociaux qui m’ont encouragée. Ils ont souligné notre complémentarité : je peux programmer des rendez-vous tôt le matin ou tard le soir, je propose ces discussions plus poussées sur le plan émotionnel… C’est parfois un tremplin vers les services sociaux, pour des personnes qui y sont réfractaires. Des cadres socio-éducatifs m’ont également contactée pour me soutenir. Un éducateur spécialisé m’a dit qu’il s’était lancé dans une aventure proche de la mienne en 1992, à une époque où il estimait ne plus arriver à accompagner les enfants comme il le voulait. Il a créé un cabinet d’écrivain public, puis une association organisée en accord avec son idéal professionnel. C’est génial ! J’ai donc surtout des avis positifs, même si je reçois aussi des critiques.
Sur quoi portent-elles ?
Sur le fait de faire payer les gens. Personnellement, je suis très claire sur ce point. Durant mes études, j’ai travaillé sur le don et le contre-don dans la relation d’aide professionnelle. Je voyais bien lors de mes stages que les gens qui avaient reçu de l’aide avaient besoin de se décharger en offrant des cadeaux. C’est ce qu’on appelle le contre-don. Je vois donc du sens au fait de faire payer quelqu’un, à partir du moment où je n’ai pas de grille tarifaire : c’est aux personnes de définir ce qu’elles vont payer, et cela peut être un euro symbolique. Dans cette relation d’aide où il y a un déséquilibre de fait, cela rééquilibre la relation, et ça valorise les personnes. Je m’étais donné un an pour évaluer le « pay what you want ». Et ça fonctionne bien. Les gens rient quand je leur explique le principe, ils perçoivent aussi que cela met en jeu leur liberté et leur responsabilité. Sur le plan de mon budget, il s’opère une compensation entre ceux qui paient moins et ceux qui paient plus. Après, j’avoue que je n’accompagne pas actuellement un public en très grande précarité financière.
Quel regard portez-vous sur votre choix professionnel après cette année d’exercice ?
Je suis sincèrement très heureuse, mon approche des situations est globale et j’accorde aux gens le temps qu’il leur faut. Le seul aspect négatif est ce regard sévère porté sur mon activité par certains travailleurs sociaux. Cela en décourage d’autres, alors qu’on sait bien que le travail social est en crise et qu’il faut parfois oser des approches nouvelles.
Comment ce regard vous affecte-t-il ?
J’aurais aimé qu’il ne m’affecte pas, mais ça n’a pas été le cas. Il est difficile de ne pas se sentir soutenu par ses pairs. Du coup, quand j’ai pu avoir des doutes – pas sur les prestations que je propose, mais sur ma capacité à vivre de ce projet, à me faire connaître – cela m’a un peu fragilisée. Heureusement que je peux m’appuyer sur le témoignage des personnes que j’ai accompagnées, qui sont ravies, sur tous ces nouveaux appels qui m’arrivent et sur tous les travailleurs sociaux qui me soutiennent car il y en a beaucoup ! Mais ils ne le font pas de manière publique. Je m’appuie enfin sur des réseaux de travailleurs sociaux indépendants qui s’organisent. Cela aide à avancer car on ne se sent pas seuls.
Quels conseils donneriez-vous à ceux qui voudraient se lancer en indépendant ?
Il faut qu’ils aient conscience que ce statut nécessite d’endosser des casquettes multiples. Par exemple, cela suppose de savoir faire un site internet, et si on n’en est pas capable, cela signifie qu’il faut investir de l’argent pour que quelqu’un le fasse à notre place. De même, on n’est pas habitué, dans notre métier, à aller à la rencontre des professionnels pour expliquer ce qu’on fait. Se lancer oblige donc à se plonger dans des pratiques nouvelles, il faut l’avoir en tête. Mais j’encourage vraiment les travailleurs sociaux à ne pas se fermer à cette approche. Il y a forcément des façons différentes de travailler avec les usagers. On peut tout à fait tendre vers l’idéal de nos débuts. Ce que je fais en ce moment est beaucoup plus en adéquation qu’avant avec la conception que j’ai de mon métier.
Vous souhaitez témoigner de votre parcours personnel, faites-le nous savoir à l'adresse suivante : tsa@editions-legislatives.fr, et la rédaction vous recontactera.
| Pourquoi cette série "En quête de sens" ? |
|---|
|
Le travail social est atteint par une grave crise de sens : le sujet n'est hélas par nouveau, il était au cœur des États généraux du travail social. Mais par-delà le constat collectif, comment cette mise en question résonne-t-elle individuellement, pour les professionnels du secteur ? Comment et à quel moment chacun peut-il être amené dans son travail à se regarder et à se demander : « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? ». Lorsque la réalité de terrain s'éloigne trop de l'idéal qu'on s'était forgé de sa mission, comment surmonter le décalage ? Décide-t-on de fermer les yeux en investissant d'autres pans de sa vie, de tout lâcher, de militer, de ruser avec les contraintes, de les enfreindre ? Où trouve-t-on les ressources, l'énergie, pour conserver le cas échéant une créativité interne – créativité au service des personnes que l'on accompagne et souvent aussi de notre santé psychique et physique.
Si chacun n'a d'autre choix que de s'inventer ses propres réponses, rien n'empêche d'aller puiser de l'inspiration dans l'expérience d'autres collègues. Notre rubrique, « En quête de sens », se propose justement de vous donner à entendre la trajectoire singulière de travailleurs sociaux désireux de partager leurs interrogations, leurs découragements, leurs enthousiasmes, et les stratégies qu'ils mettent en œuvre dans ces métiers aujourd'hui si chahutés. Des métiers mis plus que jamais en demeure de penser leur propre sens pour éviter qu'ils ne deviennent – malgré eux – vecteurs de maltraitance.
|
A lire (ou à relire) :
Tous les articles de cette série sont rassemblés ici (lien à retrouver sur le site de tsa, dans la colonne de droite, rubrique "Dossiers").