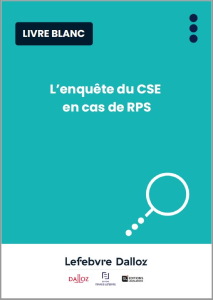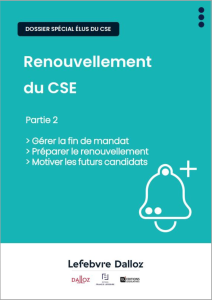L'économiste Olivier Favereau a coordonné un ouvrage de recherche intitulé "Penser le travail pour penser l'entreprise". Primé par le club d'élus CE le Toit Citoyen, cet essai critique les modes de gestion des grandes entreprises. Et propose des pistes pour donner plus de poids au travail réel et aux salariés. Interview.
"Penser le travail pour penser l'entreprise" : tel est l'intitulé d'un ouvrage collectif de recherches coordonné par l'économiste Olivier Favereau (*). Primé par le Toit Citoyen comme le meilleur ouvrage sur le monde du travail dans la catégorie expert, ce livre aux abords difficiles creuse le sillon ouvert par Pierre-Yves Gomez sur un travail qui serait devenu invisible, y compris au sein des entreprises, seule la performance étant recherchée et mesurée. Cet ouvrage exprime une critique très forte des modes de gestion à l'oeuvre dans les grandes entreprises, y compris sur le plan des ressources humaines. Les auteurs notent que ces modes de gestion ne tiennent nullement compte du travail réel des salariés, ni de leur capacité de créativité et d'élaboration. Or les salariés ne sont pas, dit le livre, seulement une des parties prenantes de l'entreprise au même titre que ses clients, contrairement à ce que proclame la RSE (responsabilité sociale des entreprises), mais ils forment une communauté qui produit le travail, ressource essentielle de l'entreprise qui devrait au moins être associée à l'organisation du travail. Or "le travail humain apparaît exclu de l'analyse du processus de création de valeur", déplorent les auteurs. Pour remettre le travail au coeur de l'entreprise, Olivier Favereau et ses co-auteurs proposent d'imaginer des espaces d'échange à la base, dans les entreprises, pour que les salariés soient associés à l'organisation du travail, et, au sommet, d'imposer au moins un tiers d'administrateurs représentant les salariés dans les conseils d'administration, afin que la gouvernance s'intéresse au travail réel. Interview.
FIn 2008, le collège des Bernardins (**) a lancé un appel d'offres dont mon université a eu connaissance (Ndlr : Olivier Favereau était alors directeur de l'école doctorale "Economie, organisations, société" de l'université Paris X et de l'Ecole supérieure des mines de Paris). Cet appel d'offres visait à sélectionner une équipe de recherches pour financer un travail sur la thématique : "Responsabilité et propriété". Or j'avais déjà en tête, avec des collègues d'autres disciplines, que ce qu'on raconte sur l'entreprise, à savoir que "les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise et que ce sont eux à qui doit revenir en priorité la valeur créée", c'est tout simplement faux !

Cette conception, qui ne résiste pas à l'analyse du point de vue du droit, a toute une série de conséquences fâcheuses. Notre sélection à l'issue de cet appel d'offres a donc été le point de départ de toute une recherche collective qui se poursuit toujours, et dont notre livre n'illustre qu'une partie portant sur les trois dernières années. Un des axes de cette recherche était centré sur la question du travail. Cette recherche a été stimulée par une réflexion d'Agnès Naton, qui représentait la CGT, lors d'une discussion au collège des Bernardins organisée par le club Réalités du Dialogue Social (RDS). Agnès Naton avait regretté que les syndicalistes, parce qu'ils se sont concentrés sur les à-côt��s du travail certes importants (la rémunération, les conditions de travail, etc), aient quelque peu perdu de vue "le contenu concret du travail". En tant qu'économiste, sociologue, chercheur en gestion, cette réflexion nous a interpellés. Nous avons découvert que dans toutes ces grandes disciplines, on ne parlait pas du travail, sinon d'une façon essentiellement négative comme en économie.
Représentants du personnel
Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux. Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.
Oui, notre approche est complémentaire. Lui soutient que le travail réel est dans les faits, dans les entreprises, dans leur gestion, devenu invisible. Nous ajoutons pour notre part que le travail était déjà invisible à l'intérieur des cadres intellectuels à travers lesquels réfléchissent les économistes, sociologues et gestionnaires.
Quand je fais un cours de micro-économie et que je présente l'état de la pensée économique sur le marché du travail, je dois expliquer que le travail est vu, depuis au moins un siècle et demi, comme une source exclusive de "désutilité", comme on dit dans notre jargon. C'est quelque chose de négatif.

L'argument fondamental est que le travail est pénible, fatiguant, douloureux, désagréable, etc., et que l'individu doit recevoir une compensation salariale pour accepter de travailler. Autrement dit, si on me laissait le choix, je préférerais ne pas travailler. Dans la théorie économique contemporaine mondiale, y compris la plus sophistiquée comme celle développée par exemple par Jean Tirole, il y a deux seules sources d'utilité : le loisir et la consommation. Cela correspond à une anthropologie pour le moins limitée ! Comme économiste ou sociologue, nous nous sommes dits : "Certes, le travail peut être pénible ou dangereux mais tout de même, il est aussi source de positivité, et pas uniquement parce que mon salaire me donne accès à une vie sociale".
En effet, la sociologie du travail existe. Mais il s'agit selon notre collègue Alexandra Bidet, qui travaille spécifiquement sur "la sociologie de l'activité", d'une sociologie qui s'intéresse peu au contenu concret du travail, et bien davantage à l'organisation ou à la régulation du travail, à la socialisation permise par le travail, etc. Alexandra Bidet nous explique que le travail nous fait nous confronter à la réalité humaine et matérielle du monde, et qu'il s'y passe beaucoup de choses : même dans les travaux les plus modestes, toute la personne humaine est engagée, y compris avec son corps, et il y a presque toujours un moment de création, où l'on participe à la fabrication de la Cité.
Notre objectif peut paraître prétentieux ou naïf mais, en effet, nous tentons de mettre en lumière dans nos disciplines respectives ce qu'il peut y avoir de positif à l'intérieur même du travail. Cette recherche, nous nous en sommes rapidement rendus compte, apporte aussi de l'eau au moulin de notre démarche générale visant à renouveler l'approche de l'entreprise contre la perspective exclusivement financière. En effet, nous développons l'idée que l'entreprise est un lieu de création collective, où chacun a sa place et participe à cet effort collectif. C'est une démarche de recherche qui peut paraître académique, je le reconnais, mais notre équipe aux Bernardins inclut aussi des praticiens; nous avons par exemple dans notre groupe un ancien DRH aujourd'hui consultant, Jean-Marc Le Gall.
Nous partageons complètement le diagnostic d'Alain Supiot (***). Les manageurs sont plus préoccupés de contrôler et d'évaluer le travail que de le connaître à proprement parler. La logique de l'évaluation à des fins de pilotage conduit à une situation paradoxale : jamais il n'y a eu autant de processus d'évaluation du travail du salarié par son supérieur hiérarchique, et jamais le salarié n'a eu autant l'impression d'être ignoré de son supérieur. Le processus de financiarisation a conduit à une déformation de la réalité de l'entreprise. L'entreprise est devenue une sorte de gigantesque machine à évaluer la contribution de chacun à la performance collective de l'ensemble. Cette logique a entraîné la dictature des nombres et du quantitatif qu'Alain Supiot a si bien documentée. Cette invisibilisation du travail a été renforcée par le grand tournant financier et libéral des années 70 mais elle a des racines plus profondes, en tout premier lieu dans la théorie économique elle-même.
Il s'agit d'inverser une tendance énorme qui traverse toutes les entreprises de la planète depuis les années 70 et 80 et dont, je l'ai dit, les racines sont profondes. Ce n'est donc pas une simple réforme qui changera miraculeusement le cours des choses. Néanmoins, nous ne voyons pas comment le travail pourrait être remis à la première place sans redonner du pouvoir aux salariés eux-mêmes dans le fonctionnement des entreprises. Au fond, dans l'entreprise, tout le monde parle du travail des salariés (les manageurs, les actionnaires) sauf les salariés eux-mêmes ! Il faut créer des dispositifs où la parole du salarié pourrait s'exprimer.

Nous ne sommes pas naïfs, nous savons bien que nous vivons dans une économie capitaliste. Mais justement, pourquoi les salariés ne seraient-ils pas représentés dans les conseils d'administration ? Si les actionnaires, comme l'a démontré, le premier, le juriste Jean-Philippe Robé, qui est associé depuis le début à notre recherche, ne sont pas propriétaires de l'entreprise, pourquoi les actionnaires garderaient-ils le monopole de la désignation des représentants au conseil d'administration où se joue l'orientation stratégique de l'entreprise ? Jean-Marc Le Gall nous a fait observer que ceci s'appelle la codétermination ou la codécision et que cela ne semble vraiment pas donner de mauvais résultats en Allemagne ou en Suède. Mais cette évolution au sommet doit aller de pair avec des espaces d'échanges sur le travail à la base. En Allemagne, la codétermination ne se joue d'ailleurs pas seulement dans les conseils d'administration ou de surveillance mais aussi à la base, dans les établissements, avec un conseil d'établissement dans lesquels les salariés ont un pouvoir considérable dans l'organisation du travail, allant jusqu'à un droit de veto sur certains sujets.
Je n'aurais personnellement aucune objection à l'idée, développée dans la loi Travail, de mettre beaucoup plus de poids dans les accords d'entreprise, y compris pour revenir sur des avantages ou garanties très générales fixés par un accord de branche ou par la loi, si j'étais sûr qu'à l'intérieur de l'entreprise, le rapport des pouvoirs était équilibré entre le travail et le capital.

Mais ce n'est pas aujourd'hui le cas. De mon point de vue, la loi est donc déséquilibrée. Mais si la loi avait acté une représentation forte des salariés dans les conseils d'administration, symboliquement, cela aurait donné un signal politique très fort en faveur des salariés, surtout si l'on se souvient que ce sont les résistances du patronat qui avaient amené à renoncer à imposer la présence d'un tiers d'administrateurs salariés dans les conseils, comme le souhaitait Louis Gallois, promoteur du projet. Parfois on nous dit : "Tout cela est irréaliste, nous n'avons pas en France les partenaires sociaux qu'il faut..." Je propose alors l'expérience suivante : Imaginons une économie française où, dans toutes les entreprises d'une taille minimale, au dessus d'un seuil de bon sens, le travail serait représenté sinon à égalité avec le capital du moins dans un rapport de pouvoir équilibré dans le conseil d'administration. Et pensons aux conséquences que cela entraînerait.
Il y aurait un tout autre climat intellectuel autour des problèmes d'emploi dans l'entreprise, du rôle des organisations syndicales dans l'économie et la société française, etc. Si on pense l'entreprise comme un dispositif de création collective, cette création collective passe à l'évidence par la coopération de toutes les parties prenantes, et la codétermination ou la cogestion vont dans ce sens. Que les salariés qui font vivre l'entreprise avec leur travail soient présents au conseil d'administration (CA) où se détermine la stratégie relève en vérité de l'évidence au XXIème siècle.
D'aucuns nous demandent, en effet, pourquoi nous ne proposons pas de faire représenter dans le CA d'autres parties prenantes. On peut l'imaginer, mais cela paraît bien compliqué de faire entrer des représentants des riverains de l'entreprise, des représentants des générations futures ou d'ONG. En outre, l'entreprise, c'est avant tout un tandem entre les détenteurs de capital (les actionnaires) et les détenteurs du travail (les salariés). Même s'il faut responsabiliser ce tandem par rapport aux conséquences sur le reste de la société, il faut d'abord commercer par le consolider en le rééquilibrant.
Nos collègues chercheurs en gestion de l'École des mines insistent sur l'invention inouïe que représente l'entreprise. Ce mécanisme de création collective implantée dans une organisation marchande privée s'est mis en place dans le dernier tiers du XIXème siècle. C'est donc une institution récente et fragile, que la financiarisation et l'uberisation de l'économie mettent en péril.

Une entreprise innovatrice digne de ce nom ne saurait être une collection de travailleurs indépendants. On peut faire fonctionner un système de taxis avec un modèle basé sur des travailleurs indépendants, mais ce n'est pas cela qui va produire de grandes innovations collectives. Celles-ci supposent, dans l'entreprise, la collaboration de nombreuses personnes, et le contrat de travail me semble un meilleur support juridique, malgré tous ses défauts, qu'un contrat commercial avec des personnes supposées indépendantes. Le contrat de travail a un bel avenir devant lui. A la condition de garder cette vision de l'entreprise comme un mécanisme de création collective et à la condition de renoncer à ces modes de gestion du personnel centrés exclusivement sur une performance individuelle et quantitative.
L'expérience humaine du travail dans une organisation collective est une des expériences fondamentales de la vie humaine et de nos sociétés. Je connais un homme qui était presque SDF et qui a fini par entrer dans une entreprise d'insertion où il entretient des espaces verts. J'ai été ému par la fierté avec laquelle il m'a un jour annoncé : "Cela fait trois mois que je travaille, et je cotise même pour ma retraite !" Je ne pense pas qu'il soit judicieux de renoncer à l'objectif du plein emploi, même si cela doit s'accompagner de dispositifs pour que personne ne reste à l'écart. Couler dans le marbre l'hypothèse de la fin du travail, c'est faire passer au second plan la grandeur de ce qui se joue dans le travail salarié. Certes, le plein emploi et la fin du travail sont deux paris sur l'avenir, mais ne vaut-il pas mieux un pari positif ?
Je ne vois pas dans le programme d'Emmanuel Macron de trace évidente du fait que le modèle social-libéral de lutte contre le chômage (mis en oeuvre par la gauche de gouvernement durant le quinquennat de François Hollande) a échoué. Je ne vois pas non plus d'indication convaincante d'une rupture de méthodes et d'outils permettant d'espérer une dynamique spectaculaire de baisse du chômage. Le vrai drame est qu'il n'y ait pas, à l'intérieur de la gauche, une pensée neuve sur la façon de revenir au plein emploi dans notre contexte d'économie ouverte et mondialisée en ce début de XXIème siècle. Nous savons très bien, et c'est ce que tente de faire miroiter la candidate du Front National, comment obtenir le plein emploi dans une économie fermée : c'était plus ou moins le cas de l'économie française pendant les Trente Glorieuses. Entre 1945 et le choc pétrolier de 1973, en simplifiant, il y a eu un jeu coopératif entre les salariés et le patronat, contre la finance.

Dans une économie fermée, la bonne santé des entreprises dépend du pouvoir d'achat de leurs salariés, lesquels vont acheter ce que produisent leurs entreprises. Mais aujourd'hui, augmenter fortement les salaires profiterait aux entreprises étrangères qui exportent leurs biens dans notre pays. Peut-on imaginer un modèle gagnant/gagnant comme celui des Trente Glorieuses dans le contexte d'une économie ouverte ? C'est la grande question, à laquelle n'a pas répondu la gauche de gouvernement depuis le tournant de la rigueur de 1983. Et c'est peut–être le grand intérêt de la codétermination. Je reprends ici l'argument de Jean-Louis Beffa (Ndlr : ex-PDG de Saint-Gobain), qui milite activement pour "une codétermination à la française" (****). Comme administrateur de Siemens, il a vu à l'oeuvre un mécanisme de réconciliation entre un intérêt national (l'intérêt allemand) et l'intérêt de l'entreprise. Siemens est soumis à la concurrence internationale et donc continuellement confronté à la question des activités à délocaliser. En raison du système de codétermination, nous a rapporté Jean-Louis Beffa, tout le monde (représentants des salariés et des actionnaires) se met autour de la table pour décider quels emplois, quels équipements et quelles activités doivent rester sur le territoire allemand, et quels sont ceux et celles qui peuvent être délocalisés.

La codétermination, qui se veut par définition un dispositif institutionnel de réconciliation entre le capital et le travail, se trouve l'être aussi pour cette raison même, entre l'intérêt national et l'intérêt de l'entreprise, dans une économie mondialisée. Nous tentons de faire partager cette conception, qui nous semble à la fois pragmatique et novatrice. Les esprits évoluent depuis la loi de sécurisation de l'emploi de 2013. Devant la CFDT, Emmanuel Macron a dit ceci : "Nous croyons que mieux associer les salariés aux décisions de l'entreprise est un enjeu majeur (..) Les représentants de salariés vont faire leur entrée dans plusieurs centaines de conseils d'administration (..) et cela permettra un meilleur partage de la stratégie (..). Nous en tirerons le bilan et, le cas échéant, nous pourrons aller plus loin pour donner davantage de poids aux représentants des salariés". Nous disons pour notre part : "Chiche, c'est le moment !"
(*) "Penser le travail pour penser l'entreprise", de Olivier Favereau, Alexandra Bidet, Jean-Marc Le Gall, Helena Lopes, Baudoin Roger, Amélie Seignour, Presses des mines, 180 pages. Voir ici un extrait
(**) Ancien lieu d'étude et de formation des moines cisterciens, le Collège des Bernardins, situé rue de Poissy à Paris, a été totalement rénové en 2008 et se présente comme "un trait d'union entre l'Eglise et la société contemporaine". Redevenu propriété du diocèse de Paris, le collège mène des travaux de recherche, notamment sur l'économie et la société, dans lesquels s'inscrit la recherche co-dirigée par Olivier Favereau et Baudoin Roger.
(***) Alain Supiot, professeur au collège de France, a publié : "La gouvernance par les nombres" (Fayard, 2015), ouvrage dans lequel il estime que l'Occident a développé de nouvelles techniques visant à la réalisation d'objectifs mesurables plutôt qu'à l'obéissance à des lois justes.
(****) Voir "Les chances d'une codétermination à la française", de Jean-Louis Beffa et Christophe Clerc, édité par la fondation Cournot en 2013.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.