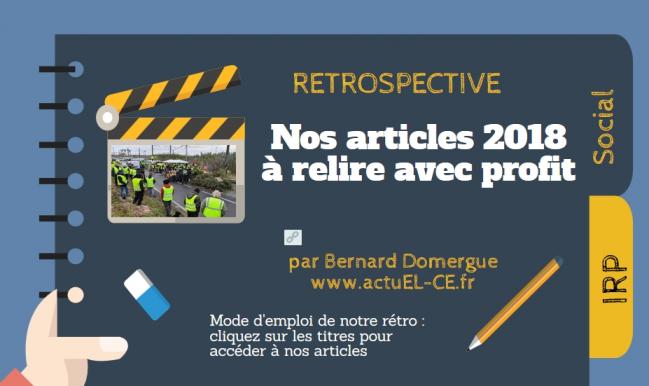Que retenir d'une année entamée par la publication du texte définitif concernant le comité social et économique (CSE) et qui s'achève sur la question du pouvoir d'achat et du partage des richesses du fait du mouvement des gilets jaunes ? Notre rétrospective.
Il est encore trop tôt pour savoir si le mouvement des gilets jaunes entraînera un changement majeur dans le contenu et la conduite des réformes menées par l'Exécutif depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017, et ce alors que le chantier très sensible des retraites se profile pour 2019. Mais la comparaison de la situation politique et sociale d'une année sur l'autre est édifiante : le vent aurait-il tourné ?
Ce que les organisations syndicales n'ont pu obtenir via leurs manifestations ou leurs prises de paroles publiques - une inflexion de la politique sociale voire fiscale menée par l'Exécutif ou, à tout le moins, une véritable prise en compte de leurs demandes - un mouvement disparate composé d'individus se réclamant du peuple et revendiquant davantage de pouvoir d'achat et d'équité fiscale va-t-il le décrocher ? Ce mouvement social pas comme les autres a conduit en tout cas le gouvernement à lâcher un peu de lest fin 2018 avec une hausse de la prime d'activité pour les bas salaires qui interviendra début février 2018, et une incitation publique à distribuer une prime exempte de charges aux autres salariés. On verra ce qui suivra à moyen terme, mais un changement de style d'exercice du pouvoir paraît à tout le moins inévitable.
Fin 2017, nous écrivions que l'année écoulée était marquée par la reprise en main par le politique des grands dossiers sociaux mais que 2018 pourrait être l'année de la confrontation au réel. A l'inverse des grandes conférences sociales du début du quinquennat de François Hollande, Emmanuel Macron a décidé de mener tambour battant ses projets, et sans tenir compte des corps intermédiaires, quitte à mécontenter des organisations syndicales : ce fut le cas des ordonnances Travail avec notamment la fusion imposée des IRP avec le CSE, le comité social et économique (► voir notre infographie ci-dessous sur les articles importants de 2018).
En 2018, l'Exécutif, tout en essayant de rassurer syndicats et patronat, a poursuivi sur sa lancée sans rien changer à sa méthode. Ainsi, les partenaires sociaux n'ont pu que constater, impuissants, que leur accord sur la formation professionnelle n'était pas repris tel quel par le gouvernement. En effet, le pouvoir a décidé un véritablement chamboulement de l'apprentissage et de la formation professionnelle en imposant sa vision d'un marché de la formation davantage transparent sur ses coûts et son efficacité et dont l'individu serait le centre.
Ce pari, audacieux mais très critiqué, constitue un énorme chantier (►voir les articles de notre dossier) dont la réalisation prendra plusieurs années. L'Exécutif, qui a totalement supprimé, au nom de l'emploi et du pouvoir d'achat, en octobre 2018 la part salariale des cotisations chômage après avoir supprimé la part salariale sur les cotisations maladie début 2018 , a également imposé à deux reprises, en début d'année puis à l'automne, aux organisations syndicales et patronales de renégocier la convention de l'assurance chômage, l'Etat souhaitant imposer des économies mais aussi une universalisation du régime. Si bien que la situation fin 2018 restait assez confuse sur le sujet : est-on toujours en présence d'un système paritaire ou d'un système hybride dans lequel l'Etat, qui assure une partie du financement via la CSG (dont le taux a augmenté de 1,7 point début 2018), veut imposer ses choix ? Le rapport de forces entre les organisations syndicales, le patronat et l'Etat pourrait bien avoir été quelque peu rééquilibré au profit des partenaires sociaux du fait de la colère sociale exprimée en novembre et décembre, même si ce mouvement social impromptu constitue aussi un défi posé aux organisations syndicales...
En 2018, il est encore très tôt dans le quinquennat pour évaluer l'effet de ces réformes dont certaines, comme le projet de loi pour la croissance des entreprises (Pacte) qui contient de multiples dispositions jugées souvent décevantes par les syndicats (seuils sociaux, épargne salariale, définition de l'entreprise et gouvernance, écarts de rémunération) mais prometteuses par certains observateurs (voir notre article sur l'analyse des juristes des Bernardins) ne sont même pas votées définitivement et quand d'autres, comme l'index sur les différences salariales entre les femmes et les hommes, ne sont pas publiées.
En revanche, un changement commence à se traduire dans le paysage social : c'est celui qui résulte de la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE). Rappelons ici, contre l'affirmation selon laquelle tout était déjà prêt dès septembre 2017, que le texte des ordonnances aura bougé jusqu'au bout de son parcours législatif, soit jusqu'au 29 mars 2018, ce qui n'est pas un gage de sécurité juridique pour les entreprises et les organisations syndicales qui s'étaient lancées avant dans le processus électoral ! (► voir toutes nos infographies sur le CSE )
Quel bilan en tirer ? Si le gouvernement a communiqué à l'automne 2018 sur le chiffre de 8 800 entreprises déjà passées en comité social et économique en disant qu'il s'agissait d'un succès, il faut relativiser : comme l'avait dit Pascal Pavageau de FO, ce chiffre n'est pas significatif car d'une part il regroupe beaucoup d'entreprises de moins de 50 salariés et, d'autre part, le passage en CSE est obligatoire. Par ailleurs, le premier rapport d'évaluation sur les ordonnances s'avère nettement moins enthousiaste à propos des 10 500 CSE instaurés au 1er septembre 2018. Très peu d'innovations sont réalisées jusqu'à présent à l'occasion de ce passage à l'instance unique, l'employeur recherchant une baisse des coûts des IRP tandis que les syndicats privilégient une attitude d'abord défensive. Une centralisation du dialogue social est également redoutée.
De fait, si l'on voit les premiers accords conclus sur le sujet, le nombre d'élus qui ressort de ce changement est en baisse notable, une baisse que les délégués de proximité parfois présents dans les accords ne parviennent qu'en partie à compenser. Il faudra regarder comment travaillent ces CSE en attendant la grande vague de passages à l'instance unique qui s'annonce en 2019. Mais voir qu'une entreprise comme Axa a rechigné avant de négocier véritablement sur le CSE est de nature à inquiéter les très nombreux représentants du personnel et délégués d'entreprises bien moins loties question dialogue social.
Mais, concédons-le, quand il est négocié, le CSE permet parfois de trouver des solutions originales (comme cette commission chargée des questions DP à la Maif mais également chez Naval group, comme ce représentant de la vie sociale chez Airbus, etc) et qu'apparaît de plus en plus dans certains accords la question de la valorisation des parcours d'élus, comme chez Arkema, même s'il s'agit souvent de grandes entreprises.
Notons surtout que l'ampleur des thèmes pouvant donner lieu à négociation représente aussi un risque pour les délégués, comme nous le disait en début d'année l'avocate Béatrice Bursztein. Car ce que l'on obtient d'un côté, il faut le lâcher de l'autre, d'où par exemple ces accords, comme chez Hendrickson, où les élus s'engagent à ne pas faire d'expertise sur telle consultation chaque année en échange d'une prise en charge à 100%. Témoin aussi ces solutions clairement illégales que nous vous signalons régulièrement (voir notre dernier article "Les clauses à éviter"). La perspective de ces élections pourrait aussi avoir, espérons-le, des effets positifs, avec l'émergence de nouvelles équipes d'élus dans certaines entreprises, comme nous avons pu le percevoir en écoutant des représentants débutants venus s'informer sur les salonsCE.
La perspective d'une professionnalisation des élus (devant assumer moins nombreux de grandes responsabilités) constitue néanmoins le plus grand risque de coupure entre les salariés et leurs représentants. Peut-être le conflit des gilets jaunes résonnera-t-il dans certaines directions des ressources humaines et directions d'entreprise comme un sérieux avertissement : attention, si le corps social ne compte pas assez de relais, d'intermédiaires ni de représentants légitimes, la situation sociale peut dégénérer. Cet avertissement prémonitoire, délivrée par des observateurs comme la juriste Nicole Maggi-Germain, pourrait servir maintenant d'argument aux négociateurs salariés dans leur demande d'un abondement du nombre d'élus, d'un meilleur maillage, d'une compensation avec de nombreux représentants de proximité, notamment pour faire prendre en compte la question de la santé au travail.
|
Les 10 ans d'actuEL-CE !
|
|
En 2018, www.actuEL-CE.fr a fêté ses dix ans en donnant la parole à ses lecteurs, le plus souvent de fidèles abonnés. Vous nous avez fait part de votre quotidien de salarié et de représentant du personnel et de la façon dont vous vivez l'évolution de vos mandats. Vous pouvez retrouver tous ces témoignages très instructifs pour nous sur vos attentes et vos préoccupations dans la carte ici. Vous pouvez aussi découvrir en vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, les secrets de notre recette rédactionnelle en cliquant ici (attention, humour !). Et comme vous le verrez dans l'infographie animée ci-dessus, vous constaterez que les raisons de vous informer sur les multiples changements impactant vos mandats depuis la création d'actuEL-CE.fr n'ont pas manqué. Nous continuerons, bien sûr, de vous informer et de vous accompagner en 2019. Merci de votre fidélité ! |
Quoi qu'il en soit, l'année qui s'achève aura vu se développer de nouvelles problématiques pour les représentants du personnel (► voir les articles de notre dossier "Big data, intelligence artificielle, algorithmes et RGPD). Nous pensons ici au traitement par les entreprises des données personnelles, avec le réglement général des données personnelles (RGPD), mais aussi au développement de l'informatique algorithmique, ou intelligence artificielle, qui, en entraînant un changement des métiers, pose de nouveaux problèmes éthiques et pratiques. Des outils que les syndicats commencent aussi à utiliser eux-mêmes, comme on l'a vu avec la CFDT pour la campagne des élections professionnelles dans la fonction publique, des outils sur lesquels les syndicats s'interrogent. La CFE-CGC estime ainsi que les représentants du personnel devront de plus en plus être "les garants de l'éthique" dans l'entreprise.
Pour les syndicats, l'année aura été éprouvante. Les organisations syndicales ont du former et soutenir les équipes confrontées aux changements (CSE, négociation collective) tout en s'efforçant de réagir à la frénésie de réformes du gouvernement. FO termine l'année en espérant en avoir fini avec une grave crise interne provoquée par l'affaire des fichiers qui n'aura guère contribué à améliorer l'image des syndicats dans l'opinion. En novembre, Yves Veyrier a été élu secrétaire général de Force ouvrière après la démission en octobre de Pascal Pavageau. Ce dernier, qui succédait à Jean-Claude Mailly, n'aura donc tenu que 6 mois après le congrès de FO fin avril.
Tout en relayant la grogne des élus du personnel, la CGT a peiné à rassembler lors de ses appels à manifester et à faire entendre ses propositions, d'autant que la confédération ne semble pas vraiment jouer la carte intersyndicale ni parvenir à stopper son érosion dans ses bastions traditionnels. Quant à ses tentatives de rallier à elle les gilets jaunes, sur le terrain d'une convergence des luttes où Solidaires se montre très active, elles semblent pour l'heure infructueuses, un bilan plutôt inquiétant à l'approche du 52e congrès de la CGT, prévu en mai 2019 à Dijon.
La CFDT pour sa part semble confortée par son congrès de juin qui a permis d'effacer les critiques exprimées par certains de ses militants sur son approche des ordonnances, et par le fait qu'elle peut prétendre maintenant au titre de premier syndicat français, son cumul d'audience dans le privé et le public dépassant celui de la CGT. Mais cette dernière et incontestable victoire est paradoxale car la CFDT n'a pas vraiment progressé dans le public (le seul syndicat qui le fait réellement est l'Unsa, qui tiendra son congrès en avril 2019 à Rennes), le scrutin ayant été surtout marqué par la forte abstention et par le recul de la CGT. La fin d'année aura également vu la CFDT s'imposer à nouveau dans le débat public, avec notamment les prises de position publiques de Laurent Berger, qui a proposé, très tôt, au gouvernement de sortir de la crise des gilets jaunes par la concertation.
L'absence de prise en compte par le gouvernement des revendications syndicales empêche pour l'heure toutes ces organisations de pouvoir présenter des avancées substantielles à leurs militants, alors même que le mouvement des gilets jaunes aura au moins permis aux bas salaires d'obtenir davantage de pouvoir d'achat. Une situation risquée, tant du point de vue de l'Exécutif que des corps intermédiaires. Le cycle de concertations qui s'ouvre dans les régions va-t-il apporter des réponses à cette crise sociale et à cette crise de la représentation ? Réponse, peut-être, en mars prochain.
|
Les activités sociales et culturelles toujours sur la sellette ?
|
|---|
|
Les tâtonnements, voire le bricolage, improvisés en urgence par le gouvernement pour tenter de revaloriser le pouvoir d'achat des salariés payés au Smic sans augmenter le salaire minimum, via la revalorisation de la prime d'activité et une prime exceptionnelle, ont été précédés, en novembre, d'un autre couac, à moins qu'il ne s'agisse d'un ballon d'essai, concernant les activités sociales et culturelles (ASC). Un amendement parlementaire et un sous-amendement du gouvernement, tous deux finalement écartés du budget 2019 de la sécurité sociale voté par les députés, visaient à "sécuriser" le régime d'exonération fiscale et sociale dont bénéficient, par simple tolérance, les CE/CSE qui font profiter les salariés d'activité sociales et culturelles, mais en instaurant une limite forfaitaire moins avantageuse pour les comités. La mesure a été reportée sine die du fait de la bronca suscitée chez les représentants du personnel mais aussi chez les prestataires des CE/CSE, qui ont rapidement fait valoir leurs arguments et leurs intérêts. La problématique du pouvoir d'achat enterrera-t-elle définitivement cette idée qui, malgré ce qu'en disent ses promoteurs, ne peut qu'entraîner davantage de cotisations sociales en contrepartie d'une sécurisation du régime, ou bien cette idée déjà avancée en 2016 par la majorité socialiste refera-t-elle surface en 2019, l'Etat devant trouver de nouvelles rentrées sociales et fiscales ? Un groupe de travail doit plancher sur le sujet. A suivre... |
Représentants du personnel
Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux. Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.