Sciences Po Rennes a organisé une journée de réflexion scientifique sur le thème "Quels territoires et quelles régulations pour gouverner les solidarités". L'occasion de croiser des approches historiques, sociologiques voire juridiques. Zoom sur la solidarité, la coconstruction, le rétablissement, le déclassement, l'intercommunalité et la recentralisation du social.
Les professionnels de l'action sociale s'en rendent compte tous les jours : les formes de leur intervention et même ses objectifs évoluent au fil des décennies. A une approche d'accompagnement individualisé s'est substituée une volonté de prendre en charge dans une approche collective en lien étroit avec le territoire. Mais comment ces débats d'aujourd'hui sont-ils rattachés à une histoire complexe où se mêlent intervention de l'Etat et présence active des corps intermédiaires ? Un séminaire scientifique le 24 janvier à Rennes à l'invitation de Sciences Po et en partenariat avec l'école Askoria a réuni plusieurs centaines d'étudiants, chercheurs et professionnels. Retour sur cette journée avec quelques thèmes abordés.
La solidarité dans l'histoire
Le professeur Marc Rouzeau (également directeur de la recherche à Askoria) a rappelé que Léon Bourgeois, président du Conseil de la fin du 19e siècle, a fait voter l'obligation de s'aider. Les premières formes d'assistance sont nées à cette période. Tout cela s'inspire de la pensée du sociologue Emile Durkheim qui a distingué deux formes de solidarité : la solidarité mécanique et la solidarité organique. Pendant la Résistance, le projet qui se dessine s'éloigne de cette vision solidariste en voulant construire l'Etat social. Paradoxalement, la période des Trente Glorieuses qui suit la guerre a voulu faire disparaître la question sociale. "Pendant cette période, analyse le sociologue Nicolas Duvoux, l'Etat avait absorbé l'essentiel de la solidarité". D'ailleurs, "ceux qui y échappaient étaient considérés comme des cas sociaux", explique Marc Rouzeau. Aujourd'hui, tout a changé. "Les Etats ne sont plus en capacité de résoudre la question sociale", souligne le chercheur Thomas Aguilera. D'autant que certains acteurs refusent désormais l'intervention d'en haut. Et que, explique le sociologue Nicolas Duvoux, "ont émergé des besoins croissants dans toutes les directions" alors même que l'Etat connaissait une crise de légitimité."
Démarche de coconstruction
"On assiste à la libéralisation d'une partie de la protection sociale, à la contractualisation de l'aide sociale et à l'activation des politiques sociales, à l'émergence de services sociaux collaboratifs et à l'expérimentation des contrats d'impact social." (1). Exemple d'un service collaboratif : le centre social coopératif de Saint-Denis. La chercheuse Lamia Bouadi explique comment les centres sociaux ont vu leurs missions évoluer. "Dans les années 20, il s'agissait de prendre en charge les problématiques des ouvriers. A la fin de la guerre, les centres sociaux ont bénéficié d'un agrément. A partir des années 90, ils se sont affirmés comme des acteurs de développement local et ont cherché à s'affranchir des institutions politiques." Le centre social de Saint-Denis envisage de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). En fait, c'est la démarche de coconstruction qui s'impose un peu partout. Les critères de classification professionnels / bénévoles ne collent plus toujours à la réalité vécue sur le terrain.
La recherche du rétablissement
Le chercheur Mathias Seguin a suivi un programme de prévention des expulsions locatives dans le 20e arrondissement de Paris en lien avec un CHRS. Il a constaté que "les outils du rétablissement peuvent être appliqués aux locataires en difficulté." Ce terme de rétablissement, expérimenté notamment au Québec, est emprunté au domaine de la psychiatrie. "On ne guérit plus, on se rétablit", explique-t-il. Le programme Un chez soi d'abord participe de cette logique. L'objectif de ce rétablissement est de permettre à chacun d'avoir une vie épanouie, d'aller mieux. "On se détache de la question sociale pour se polariser sur la question du bien-être", précise Mathias Seguin. La question du rétablissement envahit toutes les dimensions de l'action publique (le chercheur parle de "frénésie"). Il permet, non sans ambiguïté, de reconsidérer les choses : "L'expulsion n'est plus vue comme un échec, mais comme une étape dans un parcours de vie." Cette approche ne fait pas l'unanimité : "Des professionnels contestent certaines façons de mettre en oeuvre le rétablissement".
Déclassement professionnel
Olivier Leproux et Charlène Charles ont étudié les dispositifs de réussite éducative mis en place par des foyers de l'ASE. Ils ont constaté l'émergence de nouvelles professions, en la personne des médiateurs sociaux ou des référents de parcours. L'apparition de ces nouvelles fonctions se fait un peu dans le désordre : aucune qualification ne leur est proposée et les contrats sont souvent sur des durées courtes. D'où cette conclusion des deux chercheurs : "Les enfants instables sont gérés par des personnels instables." L'universitaire Caroline Arnal constate dans les nombreuses expérimentations un déclassement des intervenants. Un professionnel d'Askoria explique qu'il y a une "tension entre des équipes flexibles et des équipes qui s'accrochent à leur identité professionnelle."
Difficile intercommunalité
"Léon Bourgeois plaçait au centre de l'intercommunalité la question sociale. Un siècle plus tard, le social est resté à la marge". Le professeur Thomas Frinault s'interroge : pourquoi la question sociale s'est si difficilement partagée entre les communes ? Il y voit notamment le fait que les associations se sont construites à l'échelon des communes.
Menacés par des lois de rationalisation, les CCAS se sont lancé dans la construction de structures intercommunales. Actuellement, les choses progressent puisque 40 % des EPCI ont pris la compétence sociale. La proportion est encore plus importante dans les petites intercommunalités. Contrairement à des idées reçues, cette organisation ne s'est pas développée pour être un outil de rationalisation, mais comme un moyen d'en faire plus.

Recentralisation des politiques sociales
Depuis quelques années, l'idée circule selon laquelle de façon plus ou moins insidieuse, l'Etat cherche à reprendre la main sur des politiques sociales confiées massivement aux communes et aux départements. Nicolas Duvoux (photo) relativise le propos. "Pendant les 30 Glorieuses, l'Etat avait absorbé l'essentiel de la solidarité. Les acteurs privés avaient tendance à minorer leur intervention pour se couler dans la prééminence de l'Etat". Aujourd'hui, constate-t-il, l'Etat est en crise de légitimité. Pour qu'une politique sociale ait une chance de réussir, il faut que les acteurs s'en saisissent. Voilà pourquoi, explique-t-il, le non-recours au RSA s'est développé, marquant l'échec de cette réforme.
(1) Citation extraite de l'appel à communications pour la journée



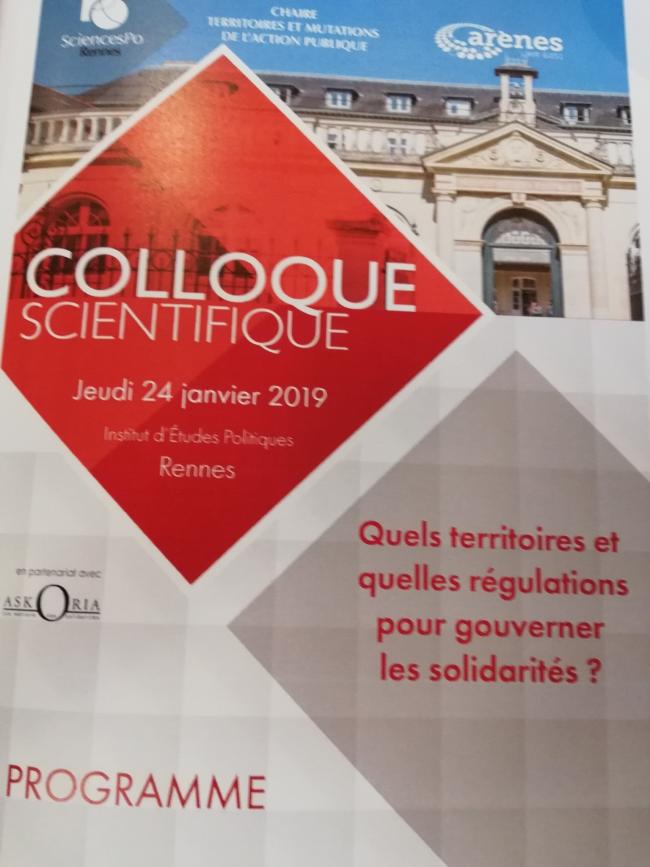



 Recentralisation des politiques sociales
Recentralisation des politiques sociales

